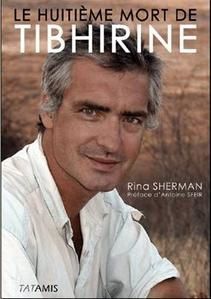Eve de ses décombres :
L’oratorio des adolescents perdus
par Caroline Tricotelle
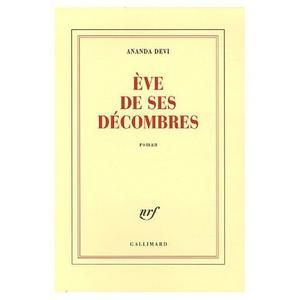 D’une totale maîtrise, Eve de ses décombres, le dernier roman d’Ananda Devi, paru chez Gallimard en 2006 et récompensé à juste titre du prix Inter et des Cinq continents de la Francophonie, laisse surgir l’image d’un lieu retranché du progrès. « Troumaron, c’est une sorte d’entonnoir ; le dernier goulet où viennent se déverser les eaux usées de tout un pays ». « Nous sommes accolés à la montagne des Signaux », (page 13). Quartier déshérité de Port-Louis, sur l’île Maurice, Troumaron représente un espace tristement actuel, cerné par le chômage et la violence. Mais en même temps, il apparaît comme une métaphore douloureuse de l’existence saisie entre destin et survie. Au-delà du réel, l’insularité devient alors une façon de ressaisir le thème biblique de la Chute ; et le roman, le moyen poétique de recueillir avec plus de sensibilité des voix en prise avec la fatalité et l’exclusion.
D’une totale maîtrise, Eve de ses décombres, le dernier roman d’Ananda Devi, paru chez Gallimard en 2006 et récompensé à juste titre du prix Inter et des Cinq continents de la Francophonie, laisse surgir l’image d’un lieu retranché du progrès. « Troumaron, c’est une sorte d’entonnoir ; le dernier goulet où viennent se déverser les eaux usées de tout un pays ». « Nous sommes accolés à la montagne des Signaux », (page 13). Quartier déshérité de Port-Louis, sur l’île Maurice, Troumaron représente un espace tristement actuel, cerné par le chômage et la violence. Mais en même temps, il apparaît comme une métaphore douloureuse de l’existence saisie entre destin et survie. Au-delà du réel, l’insularité devient alors une façon de ressaisir le thème biblique de la Chute ; et le roman, le moyen poétique de recueillir avec plus de sensibilité des voix en prise avec la fatalité et l’exclusion.
Mais l’intensité du roman Eve de ses décombres tient surtout au passage à l’adolescence de chacun des personnages, à ce moment où Eve, Sad, Clélio et Savita accèdent à cette conscience trop aiguë d’eux-mêmes et du monde qui les entoure. Elle tient aussi au choix narratif de l’auteure qui restitue leur point de vue afin de faire ressortir le contraste de leurs expériences alors qu’un événement dramatique les oriente définitivement.
En effet, dans une première partie, le roman dévoile la multiplicité ambivalente des personnages pour les projeter dans une seconde partie sur un fond d’enquête policière. Après un prélude énigmatique d’Eve, Sad fait l’épreuve de son impuissance comme celle des mots qu’il aime et qu’il dédit à Eve. Il regarde Eve s’abîmer sans parvenir à la toucher et sans savoir comment la protéger. Clélio, lui, noie ce qui lui reste d’innocence dans une violence sans foi ni loi et s’enfonce dans la solitude. Seule Savita est entrée dans l’existence d’Eve. Son amitié permet de l’extraire du commerce de son corps qu’Eve traduit comme seul refus possible de son appartenance à Troumaron : « J’avais une monnaie d’échange : moi. […] Tout ce que je leur donnais, moi, c’était l’ombre d’un corps. […] J’ai dix-sept-ans et je m’en fous. J’achète mon avenir », page 20-21. Mais la mort traverse l’univers des uns et des autres et les fait basculer dans cet état limite où le dénuement de la condition humaine trouve son expression. Au fur et à mesure des monologues intérieurs, principalement de Sad et Eve, un chant s’installe dans ce récit où la perte des illusions se rapproche d’une perte de soi, jusqu’à le transformer en oratorio pour l’être aimé.
Six mots ; un pour chaque paume, un pour chaque pied, un pour la tête et un pour le cœur. Je dégouline rouge.
Pour la première fois, elle m’entoure de ses bras. Sa bouche est désolée, mais inflexible. Malgré mon désarroi, je mesure le centimètre qui nous sépare.
Sinon cela n’aura servi à rien, dit-elle[1].
Dans ce roman, c’est par touches délicates qu’on avance. Se dévoilent alors des zones qui interrogent l’espoir, quand l’innocence ressemble au paradis perdu.
[1] Ananda Devi, Eve de ses décombres, Paris, Gallimard, 2006, p. 155.





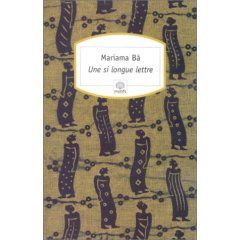 Mariama Bâ, Une si longue lettre…
Mariama Bâ, Une si longue lettre… A la croisée du conte et de l’autobiographie, Un mouton dans la baignoire est un succulent mélange de réflexions pertinentes et sarcastiques sur le disfonctionnement de l’appareil politique français à partir de l’expérience singulière de son auteur, Azouz Begag, romancier et sociologue projeté du jour au lendemain au rang de Ministre délégué à la Promotion de l’égalité des chances. Ce livre, vierge de chapitre défini, ressemble en fait à un carnet de bord dans lequel l’écrivain relate, avec discernement et par le biais d’une subtile touche d’ironie, les épreuves traversées au cours de ses deux années passées au sein du gouvernement.
A la croisée du conte et de l’autobiographie, Un mouton dans la baignoire est un succulent mélange de réflexions pertinentes et sarcastiques sur le disfonctionnement de l’appareil politique français à partir de l’expérience singulière de son auteur, Azouz Begag, romancier et sociologue projeté du jour au lendemain au rang de Ministre délégué à la Promotion de l’égalité des chances. Ce livre, vierge de chapitre défini, ressemble en fait à un carnet de bord dans lequel l’écrivain relate, avec discernement et par le biais d’une subtile touche d’ironie, les épreuves traversées au cours de ses deux années passées au sein du gouvernement.