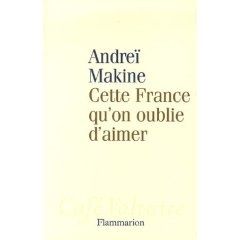

La Plume Francophone a changé d'hébergeur. Désormais, pour retrouver votre blog et découvrir ses nouveaux articles, veuillez cliquer ici.
L'équipe du blog
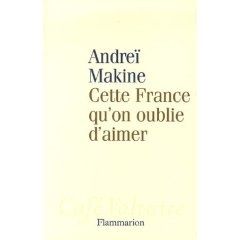
Au temps du fleuve Amour d’Andreï Makine
ou le parcours des découvertes
 En 1994 Andreï Makine publie ce roman qui retrace les souvenirs d’un jeune russe et de ses deux amis. Dimitri, protagoniste et narrateur du texte, nous fait partager l’expérience mythique du passage de l’enfance à l’âge adulte, dans un village de Sibérie, non loin du fleuve Amour. Sans pouvoir le préciser, nous pouvons situer ces moments évoqués par le narrateur dans les années 70. Les trois personnages qui évoluent dans un environnement naturel et social très dur sont obligés de faire face à différents facteurs qui vont déterminer le cours de leurs vies. Ainsi, l’hiver presque éternel qui rend la vie difficile dans les terres de la Sibérie orientale n’est pas le seul élément qui conditionne l’adolescence de Dimitri, Samouraï et Outkine. La déchirure causée par la Seconde Guerre mondiale, les rigueurs du régime communiste sont des questions que le narrateur aborde dans sa réflexion. Dans l’imaginaire des personnages, les notions d’Occident et d’Orient perdent presque toute valeur dans cette région à mi-chemin entre l’Europe et l’Asie, géographiquement, historiquement et culturellement.
En 1994 Andreï Makine publie ce roman qui retrace les souvenirs d’un jeune russe et de ses deux amis. Dimitri, protagoniste et narrateur du texte, nous fait partager l’expérience mythique du passage de l’enfance à l’âge adulte, dans un village de Sibérie, non loin du fleuve Amour. Sans pouvoir le préciser, nous pouvons situer ces moments évoqués par le narrateur dans les années 70. Les trois personnages qui évoluent dans un environnement naturel et social très dur sont obligés de faire face à différents facteurs qui vont déterminer le cours de leurs vies. Ainsi, l’hiver presque éternel qui rend la vie difficile dans les terres de la Sibérie orientale n’est pas le seul élément qui conditionne l’adolescence de Dimitri, Samouraï et Outkine. La déchirure causée par la Seconde Guerre mondiale, les rigueurs du régime communiste sont des questions que le narrateur aborde dans sa réflexion. Dans l’imaginaire des personnages, les notions d’Occident et d’Orient perdent presque toute valeur dans cette région à mi-chemin entre l’Europe et l’Asie, géographiquement, historiquement et culturellement.
Malgré toutes les difficultés que ces points de conflits puissent supposer, les trois personnages de Makine entreprennent la lourde tâche de devenir adulte, comme le font tous les adolescents du monde. Cette traversée des âges de la vie est intimement liée à la naissance du sentiment amoureux et au développement de la sensibilité chez les jeunes garçons. L’auteur fait coïncider plusieurs découvertes dans la narration de ces années de jeunesse et pour ce faire, il récupère la polysémie du terme « Amour ». Dans notre texte le mot fait aussi bien référence au long fleuve qui constitue la frontière naturelle entre la Russie et la Chine qu’au sentiment éprouvé vis-à-vis de la personne aimée. Le développement du caractère polysémique du mot « amour » permet à l’auteur de construire deux découvertes parallèles.
La première, située au niveau de l’histoire, est vécue par Dimitri et ses compagnons. Il s’agit dans ce cas de la découverte de l’amour en tant que sentiment et attraction sexuelle, redécouverte de la figure féminine et de leur propre identité de jeunes hommes :
Il me fallait tout de suite comprendre qui j’étais. Faire quelque chose de moi-même. Me donner une forme. Me transformer, me refondre. M’essayer. Et surtout découvrir l’amour. Devancer la belle passagère, cette fulgurante occidentale du Transsibérien. Oui, avant le passage du train, je devrais me greffer dans le cœur et dans le corps ce mystérieux organe : l’amour[1].
La deuxième découverte proposée par Makine est effectuée par le lecteur. L’Amour, cette fois-ci le fleuve, est un topo qui lui permet de dépeindre la culture des villages de Sibérie orientale dans les années 70. Ainsi, avec le fleuve évoqué par l’auteur, le lecteur découvre le monde de la taïga, dans lequel la neige et le froid semblent rythmer la vie des habitants.
J’entrais dans l’isba, j’entendais le sifflement paisible de la grande bouilloire sur le poêle, je voyais ma tante préparer le dîner : quelques pommes de terre, du lard glacé qu’elle venait de retirer du petit cagibi accolé à l’isba – notre frigo -, du thé avec des biscuits au pavot… Le bleu, derrière la petite fenêtre tapissée d’arabesques de glace, virait lentement au violet, puis au noir[2].
De cette façon, ce temps du fleuve Amour raconté par Makine donne lieu à une double aventure. Le lecteur est invité à rentrer dans le texte et à faire, lui aussi, sa propre découverte. L’auteur n’hésite pas à mettre en valeur les particularités de ce peuple qui, tout en étant lié à la Russie, se voit si loin et si différent de la culture et de la réalité des grandes villes russes occidentales comme Moscou et Saint-Pétersbourg. L’impossibilité de rejoindre géographiquement et culturellement ces villes ne fait que renforcer l’obsession des jeunes pour l’Occident. Cette notion, assez vague au départ, représente pour Dimitri et ses amis un monde magique, fabuleux, qui n’est pas forcément attaché à une réalité concrète. Mais un événement central dans le texte va donner place à une nouvelle découverte.
La projection d’un film de Jean-Paul Belmondo dans le cinéma d’une ville voisine attire d’une façon presque incantatoire les trois jeunes du texte de Makine. Dimitri et ses compagnons vont assister ainsi aux dix-sept séances de Le Magnifique[3] et vont découvrir de la main de Belmondo un Occident encore plus fascinant.
Et Outkine émergeant de sa crise d’épilepsie formula toutes nos émotions dans une seule exclamation, en parlant encore du film :
- C’est ça, l’Occident !
[…] L’Occident était là. Et, la nuit, les yeux ouverts dans l’obscurité bleutée de l’isba, nous rêvions de lui… Les estivants sur la promenade méridionale n’ont certainement pas remarqué les trois ombres indécises. Ces trois silhouettes contournaient une cabine téléphonique, longeaient la terrasse d’un café et suivaient d’un regard timide deux jeunes créatures aux belles jambes bronzées…
Nos premiers pas en Occident[4].
Dans le monde fantastique des films de Belmondo, le héros rusé côtoie des belles femmes, dans des paysages paradisiaques, pour confronter ensuite les malfaiteurs et gagner la gloire. L’Occident se voit enrichi dans l’imaginaire des adolescents sibériens d’une nouvelle figure masculine qui devient leur modèle : celle de Belmondo. Mais également la femme est dotée des attributs que les Sibériennes semblent cacher : l’exubérance des corps et surtout leur nudité sur l’écran marquent les esprits des jeunes garçons.
Ainsi, le cinéma français offre l’occasion d’une nouvelle découverte de la part des personnages de Makine. Néanmoins, ce choix de l’auteur met en relief un facteur qui détermine les différentes représentations de l’Occident et de l’Orient dans le texte. Il s’agit du caractère fictionnel des films de Belmondo. L’Occident est construit dans le discours de Dimitri à partir d’une fiction. Le texte cinématographique donne naissance à une perception de l’Occident, également fictionnelle. Ainsi, Makine évite tout raccourci entre la construction discursive de l’Occident dans Au temps du fleuve Amour et une référence extra-textuelle. D’ailleurs, les personnages semblent avoir conscience de la nature fictionnelle du monde de Belmondo :
Nous avons revu le film dix-sept fois. […] L’intrigue fut apprise par cœur. Nous pouvions désormais nous permettre d’examiner ses alentours et ses décors : un meuble dans l’appartement du héros – quelque petite armoire à l’usage inconnu, que le metteur en scène ne remarquait sans doute pas lui-même. Un tournant de la rue que l’opérateur avait cadré sans y attacher la moindre importance. Ou le reflet d’une matinée grise de printemps parisien sur la longue cuisse de la belle voisine endormie à demi nue près de la porte de notre héros. Oh, ce reflet ! Il était devenu pour nous la huitième couleur de l’arc-en-ciel ! La plus nécessaire à l’harmonie chromatique du monde[5].
Cette réflexion sur le caractère fictionnel de l’Occident proposé par les films de Belmondo incite le lecteur à mener à son tour une réflexion sur la représentation de l’Orient et de la Sibérie. Comme les deux faces d’une même monnaie, le lecteur prend ses distances par rapport à la peinture exotique que Makine lui propose. Il s’agit dans les deux cas, monde occidental et monde oriental, de productions littéraires qui ne voient pas l’exigence du vraisemblable. En ce sens, il est possible de concevoir la découverte du monde comme imaginaire littéraire.
Cette découverte se voit renforcée par le contact avec la littérature et la langue française que les trois jeunes garçons établissent à partir du personnage d’Olga. Cette figure féminine est intimement liée au monde occidental, car elle semble avoir été une jeune fille aisée de Saint-Pétersbourg avant la révolution d’octobre. Ses origines et son ancien cadre de vie rappellent la francophilie de la société russe occidentale, fait qui transformera le personnage d’Olga en agent de transmission de la littérature française.
Après avoir été séduits par les films français, Dimitri et ses amis cherchent à mieux comprendre la conception du sentiment amoureux véhiculé par l’Occident. À ce moment, les lectures d’Olga offrent les réponses au désir de découverte des adolescents :
J’étais quelqu’un qui savait déjà, grâce à la bibliothèque d’Olga, que les châtelaines féodales avaient un corsage long comme celui de la malheureuse Emma. Que les épaules d’une odalisque au bain étaient recouvertes d’une couleur ambrée… Qu’il fallait être un vrai goujat, comme ce hobereau chez Maupassant, pour demander à l’hôtelière de préparer un lit à midi, divulguant ainsi ses intentions à l’égard de sa jeune épouse cramoisie… Instruit par Musset, je savais que les amoureux romantiques choisissent toujours une matinée froide et ensoleillée de décembre pour se séparer à jamais…[6]
Cette approche de la littérature française accompagne naturellement une fascination pour la langue française. Bien que les films de Belmondo soient doublés, les trois jeunes spectateurs devinent sur les lèvres la langue magique de l’Occident et de l’amour. Les lectures des textes en français qu’Olga propose aux garçons complètent l’envoûtement que cette langue provoque chez eux.
Ce parcours de découvertes semble aboutir à une prise de conscience du pouvoir de la langue et de l’écriture littéraire, comme moyen de construction d’un imaginaire. Cette réflexion est appuyée par l’analepse qui permet à Dimitri de retracer ses souvenirs d’adolescence. En effet, le texte de Makine commence avec une réflexion sur la relation entre la matière et la forme d’un texte. Il s’agit d’une sorte de dialogue entre Outkine et Dimitri, tous les deux sensibles à l’écriture littéraire. Les expériences de jeunesse qui suivent cette introduction semblent ainsi montrer la genèse des personnages, qui vont façonner leurs identités au fil des découvertes. Makine accompagne encore une fois ses personnages en construisant son texte comme une fiction littéraire.
Victoria Famin
[1] MAKINE, Andreï, Au temps du fleuve Amour, Paris, Gallimard, 1994, p. 65.
[2] Ibidem, p. 58.
[3] Film réalisé par Philippe de Broca en 1973, avec Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset.
[4] MAKINE, Andreï, Au temps du fleuve Amour, Op.cit., p. 112-113.
[5] Ibidem, p. 119.
[6] Ibidem, p. 228.
La femme qui attendait…
Lire pour la promesse arrêtée

Le titre de l’ouvrage d’Andreï Makine se prête en effet aux infinies possibilités. Mais dans La femme qui attendait[1], il est question d’en fixer le possible infini. Titre apéritif ? Madeleine ou gâteau sec ? Comme dans Le testament français, [2]Makine creuse la question proustienne de la promesse de l’écriture : restituer l’être, insaisissable par définition. Au-delà de la contradiction, la fugacité de l’instant reste l’objet de toutes les tentatives. Spéculaire pour certains, mais à la portée de l’art pour d’autres. C’est l’enjeu de la littérature ou sa poétique en tant que mode d’accès à une dimension sublime. Aussi est-il intéressant de lire ce livre écrit alors que son auteur peut prétendre être un écrivain accompli[3]. En effet, dans ce roman, il s’astreint précisément à interroger les modalités de l’accomplissement littéraire que motive son plaisir d’écrivain. Mais ce qui apparaît surprenant dans ce livre, c’est la place de la culpabilité dans cette motivation. C’est précisément dans ce rapport ambigu qu’apparaît le lien personnel de Makine à l’écriture, ce qui le rattache à son œuvre, en plus des retrouvailles avec cette Russie qui ne cesse de nourrir sa littérature. On peut dire en effet qu’au coeur de l’expérience universelle du temps, se glisse celle de l’écrivain : refoulé du présent puisqu’il s’accomplit dans l’écriture, toujours inscrite dans l’après-coup.
Qu’engendre cette condition singulière de l’écrivain lorsqu’il est le narrateur du récit ? C’est ce que nous tenterons d’analyser à travers le jeu avec la temporalité permis par la structure narrative de La femme qui attendait. Puis nous observerons l’espace intérieur frayé par l’espace narratif tel une fêlure primordiale. Enfin nous aboutirons à la question de la résistance au temps de l’écriture : métaphore ou compensation de l’existence.
Que le narrateur soit écrivain nous renvoie immédiatement à une sensibilité spécifique : celle du temps. Quant à la fiction, elle suppose des lois internes. Makine choisit le moment exact de la mise en texte pour établir une stratégie romanesque complexe : celle du croisement de différentes temporalités. La matière première de ce roman est un moment vécu par le narrateur, approximativement une dizaine d’années avant la chute du Rideau de fer, quelques années après mai 68, et avant qu’il n’habite en France. À l’époque, le narrateur est âgé de 26 ans et saisit l’opportunité de s’éloigner de Léningrad à la place d’un ami, pour effectuer une recherche sur des rituels à Mirnoïé, village sibérien. Contrairement à la temporalité de la mise en texte qui s’étend à l’infini, ces indices donnent un contexte au récit de référence, à l’intérieur de l’expérience du narrateur. C’est donc un récit autobiographique. Ce niveau de croisement de temporalité et cette distanciation met en évidence l’effet de rétrospection : « l’inscription paraissait sortir du néant, tel un indicateur dans le chaos d’une planète déserte » (p. 66). Mais ce terme d’inscription peut autant correspondre à un autre niveau de temporalité : une première tentative de mise en texte. Dès l’incipit, en effet, le narrateur en fait la citation et la situe exactement pendant qu’il était à Mirnoïé. La structure du récit s’organise donc à la fois en superposition grâce à la citation qui joue de la répétition pour figurer dans le texte et dans le prolongement à l’infini de l’accomplissement de l’écriture. Ces croisements mettent en évidence le regard rétrospectif et critique qui s’exerce en même temps que l’ouverture d’un espace d’écriture. Comme le dit Jacques Derrida « le passage à la conscience n’est pas une écriture dérivée et répétitive, transcription doublant l’écriture inconsciente, il se produit de manière originale et dans sa secondarité même, il est original et irréductible »[4]. Ainsi cette structure narrative représente l’hétérogénéité dynamique constituant le texte, « comme une énergie psychique entre l’inconscient et le conscient »[5]. On peut alors y voir la biographie de l’écriture possible grâce à l’autobiographie de l’écrivain. Par ailleurs, cette hétérogénéité sert le projet de l’écrivain avorté à l’époque : « j’avais compté découvrir » (p. 55). L’écrivain-narrateur, à l’époque, avait la prétention de découvrir le vrai. Mais ce n’est que dans cette distance, ce recul, qu’il prend conscience du sens de son histoire. Il peut enfin la voir car son regard se positionne à l’extérieur mettant à nu le cours de l’existence. Et à travers le cortège des personnages pris dans le regard du narrateur-écrivain, le sens semble multiple. Des mécanismes sont déconstruits, comme celle des généralités, quand le narrateur évoque les femmes, ou des modes d’existence comme le personnage Otar « la première hirondelle de l’Occident » (p.15), conducteur d’un camion de liaison qui couche avec des femmes le reste du temps. L’existence semble alors se réduire à une mécanique, « des corps qui cherchaient à s’accoupler, c’est tout » (p. 156) ou une après-vie pour les vieilles de Mirnoïé qui attendent la mort. Le motif de la poupée traverse le texte et complexifie encore le cheminement de pensée vers une réponse sur ce qui est « être vivant ». En fait, ce ne sont que des tentatives de réponse. Ce n’est que la visualisation d’une apparente logique de remplissage de l’existence. Elle ne peut satisfaire le narrateur puisqu’elle lui semble absurde pour définitivement lui échapper au regard de l’Histoire, celle-ci qui le révolte. En effet, malgré les croisements temporels qui permettent de résumer le parcours des individus, le sens reste relatif à un point de vue et au temps. Mais sa profondeur est restituée par l’écriture. Cette dimension du texte s’inscrit aussi dans la narration du fait que le narrateur doit rédiger un article sur les rituels anciens de cette région de la Russie. Le temps qui imprime sa marque sur les individus laisse planer la mort de chaque époque. Seul Mirnoïé et le temps arrêté de Véra ou des vieilles fonctionne à rebours de cette logique puisqu’il découvre, comme dans son travail d’écriture, des strates temporelles suspendues. L’écriture se charge alors de suspendre l’effacement. Elle œuvre contre l’oubli. Reste cette fêlure de toutes les certitudes lorsque la mort transparaît. Car si le temps est reconnu relatif, si le narrateur ressent une fêlure de l’absolu, c’est Véra, l’exception des logiques, « une femme qui a fait de sa vie une attente infinie » (p.59), qui trouble le narrateur. Le temps est alors vu comme expérience. Ce qui place le vécu entre temps et temporalité : c’est la fêlure primordiale.
En effet, extraordinaire est l’attente de cette femme, Véra. Elle attend depuis trente ans l’homme qu’elle aime, contre toutes logiques. Cette démesure, ce rapport au temps, déstabilise autant qu’il intéresse le narrateur puisqu’il place la fêlure primordiale de l’être sur une dimension qui le dépasse (l’infini). Pourtant, il reste attaché à cette rencontre puisqu’elle est le sujet de son écriture. S’il est resté, à l’époque, un écrivain inaccompli, c’est à cause du manque de recul. L’écrivain, en effet, était encore dans la confusion entre l’homme (parfois décliné sur le mode du bestiaire) et l’écrivain. Il n’a pas su se désengager du présent, s’en extraire pour mieux le restituer. Ce n’est qu’au moment de la mise en texte, une fois que le narrateur aura fait l’expérience du temps ou de l’approfondissement, qu’il est écrivain. C’est pourquoi on peut parler aussi du récit de l’existence de la vie intérieure.
Le narrateur revient en effet sur son vécu. Or cette histoire ne peut s’éclairer qu’à partir du moment où il la recontextualise. Elle est la conséquence d’un premier traumatisme : au Wigwam, atelier d’artiste, la femme qu’il aime est à côté de lui. Puis il l’entend coucher avec un autre homme. Ce contexte semble anecdotique : un seul chapitre sur dix-sept répartis sur trois parties presque parfaitement homogènes d’après le nombre de pages. C’est pourtant cette scène qui le poussa à se rendre à Mirnoïé. « Interdit de se souvenir », (p. 30), « “Pas de jalousie, pas de jalousie. Tu es ridicule, espèce d’ours sibérien”, répétait en moi une voix, analgésique », (p.35). Partagé entre le mode d’existence des artistes sous le joug du communisme qu’ils transgressent en parodiant l’Occident, « La propriété sexuelle, le comble ridicule petit-bourgeois ! Boire, fumer en plissant les paupières (comme dans les films de Godard) » (p. 30), et l’affection qu’il ne peut contrôler, le narrateur subit un choc : la mort de l’amour. Le narrateur est alors dans un état particulier et le terme « analgésique » sous-entend un refus de la réalité pour se préserver de la douleur. Dans cet état, lui vient la révélation de l’écriture. Elle se glisse dans la faille du vécu du narrateur. Il s’agit sans aucun doute d’une compensation mais aussi le résultat (accidentel ici) d’une mise à distance, ou d’un retrait du présent. Puis cet état de conscience se prolonge jusqu’à une autre scène que l’on peut relier à la première. Il s’agit de la première fois que le narrateur voit Véra :
je crus avoir surpris un couple qui faisait l’amour […] un visage de femme surgit […] et tout de suite se renversa en arrière, dans un violent flot de la chevelure rejetée […] à ses pieds, tassé comme le corps d’un noyé […] l’eau […] telle une mince coulée de sang (p.14).
La mort et le sexe se tiennent dans ces instants furtifs. Or Véra est seule. Elle se substitue à l’autre femme et le narrateur, à partir de ce moment, transfère sur elle un désir et entame sa fantasmagorie : « une complicité ambiguë, semblable à celle d’un acte charnel […]. L’air immobile nous emprisonnait dans une posture fixe, une inertie de mauvais songe. Et il y avait la compréhension partagée, irréfléchie et tacite, que tout était possible entre cet homme et cette femme » (p. 14-15). Ainsi, le narrateur, au moment où il vit à Mirnoïé, était soumis à ses pulsions sexuelles. Mais pas seulement. Le fait qu’au début l’acte ne soit pas consommé, maintient le désir d’écrire. Ces deux scènes prouvent l’état de dépendance du narrateur à Véra, qu’il transforma en objet de son désir sexuel et littéraire : « la tentation de comprendre comment on pouvait attendre quelqu’un toute sa vie » (p.78). Cette double dépendance est disséquée dans l’incipit. Mais les points de suspension taisent ce que l’on pourrait appeler la faille de l’être, en prise avec l’inconscient et le ça. Le risque de souffrir est comme le souvenir ou les événements qui hantent la vie psychique : impérissables. Cette emprise est permanente. Elle fait l’être. L’incipit est d’ailleurs le sommaire de l’évolution psychologique du narrateur-personnage qui traverse le récit. Mais cette faille de l’être-homme pointe la condition de l’écrivain et sa lutte intérieure dès l’instant où il se laisse aller au présent. C’est la logique du désir de vivre. Et l’évolution explicitée du narrateur, entre colère et fascination pour cette femme Véra, n’est qu’une réaction face à ce qu’il ne peut contrôler, posséder ou saisir. Le désir d’évoquer Véra est une pulsion de vie. Elle compense le manque de cette femme et la restitue dans l’acte d’écrire. Comme pour compenser la culpabilité de l’avoir quittée. Néanmoins, Véra est exceptionnelle et dans le récit, elle est sublimée. Elle est l’inverse de la femme aimée qui est « une de ces femmes qui ne savent pas attendre » (p.25). Le personnage d’Otar est celui qui informa le narrateur au sujet de Véra. Homme terrien, c’est lui qui rappelle sans cesse la particularité de Véra : hors du désir et hors-temps. Aussi, troublé par Véra qui le renvoie à cette lutte intérieure, le narrateur la suit-il dans le but de la rencontrer. Elle sera son guide vers le monde de l’idéal comme son éternel féminin. Peut-être est-elle, dans cette mesure, la véritable héroïne de l’histoire. Quoi qu’il en soit, elle incarne l’accès à une dimension poétique de l’existence. Le lieu privilégié pour leur rencontre est celui de la barque. On peut sans hésiter rapprocher cet élément narratif du topos d’un lieu entre les vivants et les morts : la barque de Caron, d’autant plus aisément qu’il leur faut enterrer Anna, une des vieilles, dont le corps n’est découvert qu’après coup par le narrateur. La narratologie respecte encore la règle de l’après-coup. De cet épisode, le narrateur garde un sentiment de surprise et d’étrangeté. C’est à partir de ce sentiment, renforcé par l’image d’une femme quasi mythique, « Andromaque paysanne » (p. 96), que le narrateur étourdi, fera l’abandon de soi. Il s’ouvrira enfin à l’instant entre la vie et la mort. La fêlure de l’être et de l’homme laisse ainsi place à la fêlure du temps : c’est une question de perception. Alors, cette fêlure devient primordiale du fait qu’elle trace un nouveau rapport au temps. Entre condensation et extension, l’éternité devient sensation vécue.
C’est donc le retour à la subjectivité et à l’interprétation des signes comme lecture de l’existence, malgré la mort. C’est ce que représente le roman de Makine : la métaphore de l’écriture en plus d’une écriture compensatoire.
Le texte lui-même instaure le jeu des signifiants. En plus de l’épisode de la barque, d’autres épisodes tendent vers le merveilleux et le fantastique. Par exemple, le narrateur surprend en pleine nuit Véra, nue, à la sortie de son bain. Cette séquence glisse vers les contes de loup-garou nonobstant la bague laissée après les faits telle un talisman. La fêlure se transforme en principe d’incertitude fertile, poétique et plein de sens. Cette zone floue et riche sur le plan paradigmatique est aussi le croisement, non plus temporel mais sémantique, de séries ou de mondes complémentaires. La présence d’un miroir fêlé dans le village ou l’épisode au cours duquel le narrateur et Véra regardent le monde dans la glace brisée représente bien la zone de contact entre deux éléments. Le haut et le bas, les vivants et les morts, le temps et le hors-temps du village de Mirnoïé et enfin le signifié et le signifiant que l’écriture allie pourtant… Ainsi toute l’ambivalence et la duplicité de l’existence trouvent son lieu de représentation dans ce glissement sémantique et le jeu du signifiant : « même la boîte aux lettres au croisement des routes perdit peu à peu, à mes yeux, sa signification de tueuse d’espoir » (p.60). On peut alors supposer que la fragmentation et les appositions dans le texte, ainsi que les croisements de temporalités sous forme de fugue sont une présentation syntagmatique d’effets plus à même de représenter l’existence et la fuite du temps. Comme dans la vie psychique, quand un être fait des rapprochements aléatoires et effectue un tri sélectif d’événements qui restent conscients ou inconscients, il crée un tout. Il en va de même dans le récit. Il est le champ d’affrontement de plusieurs forces et pulsions ainsi que leur alternance. Sur le plan de l’analyse paradigmatique aussi, on remarque un tout éclaté : par l’ironie qui libère une charge contre le réel. Le tout, dans son hétérogénéité, est donc également la surface du texte innervé par une charge compensatoire. Selon Schlegel, « l’ironie est la claire conscience de l’éternelle agilité de la plénitude infinie du chaos. […] L’ironie montre à la fois l’importance limitée de ce que nous présente le récit, qui est lié au réel, et la grandeur de l’idéal pressenti, qui éveille en nous le sens de l’infini »[6] Il déploie un récit en même temps qu’il l’inscrit sur la toile de fond de la subjectivité. Et le rire qui éclate le soir de la fête de départ d’Otar, dans la confrontation de la misère des femmes obligées de porter les mêmes sous-vêtements, ne fait que filer la fêlure du miroir, du monde et du réel. Mais si le sens provient de l’approfondissement et du retrait, l’écriture est donc bien métaphore puisqu’elle donne à voir l’espace de jeu du sens et ses transports, une sorte d’auto-réflexivité qui débouche sur l’image de l’existence, comprise après-coup. En tant que texte fini et délimité, elle est l’image même du fragment : comme expression du witz qui doit être totalement détaché du monde environnant, et clos sur lui-même comme un hérisson, comme un souvenir qui hante un écrivain, comme un nœud en psychanalyse. L’écriture est cet espace mental de la transfiguration et Véra, l’incarnation de l’écriture :
Son visage me paraît vieilli, une tresse de cheveux argentés glisse sur son front. Et pourtant, elle est tout empreinte d’une jeunesse neuve, frémissante qui est en train de naître dans le mouvement des lèvres, dans le battement des cils, dans la légèreté de son corps que la barque emporte déjà… (p. 212)
Seule demeure la matérialité des signes et de l’existence, le chaos ordonné par un dieu, un écrivain qui organise les différentes parties d’un tout, ou un lecteur à venir. L’écriture n’existe que pour se glisser entre l’absurde logique de l’existence et un éventuel destin. La littérature, plutôt que de chercher la vérité, lui préfère la véracité, quand la beauté cesse d’être intéressée et qu’elle est libérée de toutes fonctions. Ainsi, la littérature est cet espace dans lequel l’écrivain peut enfin s’inscrire. Il joue sur son défaut : le refus du champ de la présence. C’est aussi la raison de sa culpabilité. Reste à réinvestir le signe, à donner un sens, sachant que cette interprétation épuisera tous les possibles, (par exemple poétique ou littéraire), jusqu’à toucher l’éternité, quand le souvenir laisse sa trace vers un futur indéterminé de la lecture ou relecture. Pour conclure, entre le sublime et le rire cinglant de l’ironie, « l’éclat, la splendeur de l’événement, c’est le sens. L’événement n’est pas ce qui arrive (accident), il est dans ce qui arrive de pur exprimé qui nous fait signe et nous attend »[7]. C’est une relecture de Gilles Deleuze.
Caroline Tricotelle
[1] Andreï Makine, La femme qui attendait, Paris, éditions du Seuil, Points, 2004.
[2] Voici l’épigraphe de Proust dans Le Testament français d’Andreï Makine, paru en 1995, Paris, Mercure de France, coll. Folio, à la page 11 : « […] c’est avec un enfantin plaisir et une profonde émotion que, ne pouvant citer les noms de tant d’autres qui durent agir de même et par qui la France a survécu, je transcris ici leur nom véritable ».
[3] Il a reçu les prix Goncourt et Médicis en 1995 pour Le Testament français ainsi que le prix RTL-Lire 2001 pour La Musique d’une vie.
[4] Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Paris, éditions du Seuil, coll. Tel Quel, 1967, p. 213.
[5] Ibid.
[6] Idées, n° 69, L’Absolu littéraire, Ph. Lacoue-Labarthe / J. – L. Nancy, Paris, éditions du Seuil, 1978, p. 126.
[7] Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, p. 175.
Mémoires d’entre les croix
 Pour que vive un bonheur condamné, par le destin et par autrui, à devenir horreur, il faut fermer les fenêtres, tirer les rideaux. Qu’il ne soit vu par personne. Pour survivre au malheur, il faut l’accepter sans résister, en fermant les yeux, puis le ré-inventer. Ce sont là quelques leçons qui se dégagent d’un des romans d’Andreï Makine. Le Crime d’Olga Arbélina[1] est, en vérité, le récit de plusieurs crimes. Le crime historique fondateur de l’URSS, la Révolution bolchevique aux moyens et aux fins pervertis, le viol de la princesse Olga Arbélina, la relation incestueuse entretenue, malgré elle au commencement puis consentie, avec son fils, le meurtre du « médecin-parmi-nous », qui espérait la forcer à une rencontre charnelle. Au fil de la lecture, un autre crime est commis, cette fois-ci par le lecteur, qui souille, par son regard, son voyeurisme, le bonheur filial immoral.
Pour que vive un bonheur condamné, par le destin et par autrui, à devenir horreur, il faut fermer les fenêtres, tirer les rideaux. Qu’il ne soit vu par personne. Pour survivre au malheur, il faut l’accepter sans résister, en fermant les yeux, puis le ré-inventer. Ce sont là quelques leçons qui se dégagent d’un des romans d’Andreï Makine. Le Crime d’Olga Arbélina[1] est, en vérité, le récit de plusieurs crimes. Le crime historique fondateur de l’URSS, la Révolution bolchevique aux moyens et aux fins pervertis, le viol de la princesse Olga Arbélina, la relation incestueuse entretenue, malgré elle au commencement puis consentie, avec son fils, le meurtre du « médecin-parmi-nous », qui espérait la forcer à une rencontre charnelle. Au fil de la lecture, un autre crime est commis, cette fois-ci par le lecteur, qui souille, par son regard, son voyeurisme, le bonheur filial immoral.
Le récit commence dans un cimetière russe, situé à Villiers-la-Forêt, en France, où sont enterrés les immigrés russes ayant fui la Révolution bolchevique et qui ont fondé, dans les années 20, la Horde d’or. On vient de toute part visiter ce cimetière afin de « voler » quelque récit ou quelque anecdote, qui changera de la routine quotidienne, de la bouche du gardien. Un jeune étudiant, qui aspire à devenir écrivain, demande à ce vieillard de lui raconter l’histoire d’une tombe censée appartenir à un homme alors qu’elle porte le nom d’une femme. Une histoire que celui qui ressemble à un vieux Pop un peu fou va raconter pour la première fois. Ce jeune étudiant est-il « celui dont il n’espérait plus la venue ? » On n’aura sans doute jamais la réponse mais du cœur du « jardin où l’on découvre un autre regard sur la mort » (p. 23), nous entendrons l’histoire d’Olga Arbélina. C’est un beau jour d’été qu’on découvre le corps noyé dans la berge de Goletz, le « médecin-entre-nous », avec, à côté de lui, celui d’Olga à moitié nue mais toujours vivante. Dès lors, « Tout le monde à Villiers-la-Forêt durant ces mois s’improvisa conteur et détective » (p. 39). Les deux voies empruntées par le narrateur, et par-là, les deux positions que le lecteur est invité à prendre, sont déjà signalées[2]. Le roman est un roman policier. Il faut donc enquêter. Mais, au même temps, il est un conte. Il nous faut donc écouter le narrateur. Enquêter et écouter ? Les choses seraient bien plus simples si elles se résumaient à cela. En effet, un élément clef disparaît de l’œuvre jetant dans le doute la « vérité ». Qui raconte ? Le lecteur croit d’abord écouter le récit, tant protégé, du vieillard. Au fil de la lecture, une question surgit : et si c’était Olga qui nous confiait son secret ? En fin de récit, le jeune étudiant, qui « passe sa vie à deviner la vie des autres » (p. 28), reprend la parole et s’impose par un « je » nouveau. Aurait-il écrit le livre qu’il aurait soumis à notre lecture ?
Pour le lecteur de ce roman bien étrange, le conditionnel règne en maître. Rien n’est acquis d’avance. Rien ne le sera jamais après le dire. Nous avons affaire à des fils de parole. Tel une croix, le récit nous dirige vers quatre pôles, quatre vérités possibles : le Levant, le Couchant, le Divin et enfin le Souterrain. L’auditeur-enquêteur a beau chercher le décollage nécessaire pour aboutir quelque part, il s’aperçoit qu’il est toujours enfoncé sous terre, dans la boue du monde. C’est là que se débat Olga Arbélina. Son combat, elle le mène à coup de délires, de mémoires interrompues, de souvenirs rompus. Il faut confirmer son existence par des anaphores systématiques, ce « Oui » qui ouvre chaque souvenir comme si l’on n’était pas sûr de vivre. Il s’agit d’un « Oui », bouche ouverte d’où s’exprime l’homme, qui rend sensible l’être. L’un des fils du récit est donc existentiel et veut se confiner au plan individuel. Olga vit l’innommable sachant que son fils ferme les portes-fenêtres et tire les rideaux pour qu’ils ne soient vus de personne. Pourtant, au commencement, Olga était endormie par son fils qui lui glissait des somnifères dans son infusion. Une mémoire tapie, enfouie au plus profond de l’être, essaie de s’exprimer. Elle le fait par bribes. Le soupçon fait naître le « désir » d’aller au bout de la vérité en menant sa propre enquête. Elle le fera inconsciemment en ne touillant pas sa boisson pour éviter la consommation du soporifique.
Elle savait que la douleur physique comme morale, est à moitié due à notre indignation devant la douleur, à notre étonnement devant elle, à notre refus de l’accepter. Pour ne pas souffrir, elle employait toujours la même astuce : énumération. Oui, il fallait constater, d’un regard le plus indifférent possible, la présence des objets et des êtres rassemblés par la situation douloureuse. Les nommer très simplement, les uns après les autres, jusqu’à ce que leur invraisemblance totale éclate aux yeux[3].
Nommer l’« invraisemblable » dans sa totalité. Là est le combat d’Olga. Un combat qu’elle mène cette fois-ci contre elle-même. Nommer le geste devient impossible. Le nom est refoulé et l’exercice de la mémoire mis en arrêt dès lors qu’un nouveau pas vers le nom est franchi. Le Crime d’Olga Arbélina est envahi par les points de suspension qui finissent par muer le silence en une, voire plusieurs autres histoires possibles mais sur lesquelles le suspense est maintenu. Il suffit de fondre son être, un moment, dans la banalité du monde pour que le nom enterré en soi explose : « Elle remit la gouttière dans le carton, le ferma puis, ne pouvant pas refréner son désir, saisit de nouveau ce moule de plâtre, l’appliqua à sa joue, à ses lèvres. Et c’est alors que le secret résonna : “L’inceste !” » (p. 201). Suivent des tentatives de reconstruction de l’histoire. La quête d’Olga n’est plus de trouver la vérité mais de croire à la réalité et de la rendre acceptable et vivable. Inconsciemment, Olga justifie son laisser-aller : son fils est un hémophile qui ne vivra pas longtemps, elle est sans doute la seule femme de sa vie, et par conséquent… Du souvenir réprimé au souvenir exprimé, ou simplement inventé et renforcé par des détails qui le font entrer dans le domaine de croyance, Olga admet son attirance pour ce fils qui porte le manteau de l’amant parti pour ne revenir jamais. Ce dernier va se transformer en sujet de hantise. Ses départs, ses retours, incessants, ses télégrammes annonçant son retour, les retrouvailles…, tout prend l’allure d’une hypothèse justifiant l’inceste.
En acceptant d’être la seule femme de son fils condamné, Olga transforme l’horreur en bonheur. Ce mouvement changeant le mal en bien est essentiellement hypocrite, mais le tragique de la situation rend caducs les jugements moraux, d’où la grande poésie qui se dégage de ce crime, d’autant plus qu’il est réalisé dans la solitude la plus totale. Olga et son fils habitent une maison isolée dans la Horde d’or, portes et fenêtres sont fermées et les lumières éteintes. Le crime se déplace des acteurs-agents incestueux vers le lecteur. Ce dernier est un voyeuriste indigne qui, par son « désir » insatisfait, sa curiosité qui le maintient en haleine tout le long de sa lecture, gagne le pouvoir de briser le bonheur d’une mère qui n’espère plus de remède au mal de son fils et d’un enfant qui ne peut pas vivre normalement sa vie, que la moindre écorchure peut tuer. Le lecteur peut se reconnaître dans la figure de Goletz. Le « médecin-entre-nous », pour ne pas dire « ce médecin, c’est nous », est d’abord celui qui veut soigner l’enfant pour apaiser la mère, comme le lecteur, en position de psychanalyste, qui écoute les confidences délirantes d’Olga ou, peut-être, le récit étouffant le vieux gardien du cimetière. Goletz, c’est aussi cet insomniaque attiré par une malheureuse. Il la fait chanter pour obtenir ses faveurs. Repoussé, il déclare à Olga avoir tout vu car les portes-fenêtres sont plus larges que les rideaux. Il devient ce « tiers incommode » qui évoque le personnage stendhalien Ernest IV lequel, dans La Chartreuse de Parme, veut s’interposer entre Fabrice Del Dongo et la Sanseverina. Pour protéger son bonheur, Olga accepte un rendez-vous qui se termine par la noyade du médecin dans la berge de la Horde. De même, le lecteur est noyé dans d’invraisemblables récits car Olga délire. Son mal est ailleurs.
Le véritable mal qui creuse le cœur et la conscience d’Olga Arbélina, c’est l’Histoire à laquelle son histoire vient se greffer comme un corps étrange mais correspondant :
Le début de cette chronologie remontait à la révolution, à la guerre civile, à la fuite à travers la Russie incendiée par les bolcheviques. Ensuite était venue pour eux l’époque de l’enracinement à Paris, à Nice et, pour certains, dans la monotonie ensommeillée de ce Villiers-la-Forêt. Plus tard, en 1924, cette terrible décision des Français qui reconnaissait le régime des Soviets. En 1932, pis encore : l’émigrant russe Pavel Gorgoulov assassine le président Paul Doumer ! Durant quelques semaines, toute la partie russe de la ville vécut dans la peur des représailles… Puis la guerre avait éclaté et paradoxalement les avait en quelque sorte réhabilité aux yeux des Français – grâce à la victoire de ces mêmes bolcheviques sur Hitler… Enfin le tout dernier événement, cette incroyable liaison de la princesse Arbélina et du ridicule Goletz[4].
C’est dans la perversion de la révolution bolchevique et de ses aspirations que l’histoire d’Olga trouve son point de départ. Pendant la révolution, elle subit un viol dont naîtra son fils hémophile. Arrivée en France, juste avant la seconde guerre, elle finit par retrouver la misère et le mal historiques. Son fils devient ainsi la métaphore d’une terre saignée en permanence. Les dirigeants construisent l’Histoire dont seront victimes les peuples : « La révolution a été conçue moins dans la boue des quartiers populaires que dans la crasse des palais » (p. 43), ose dire Olga à son arrivée de Russie. Mais l’Histoire est toujours frappée du sceau de l’oubli. Ainsi le malheur passé est reproduit par ses victimes sur leurs bourreaux. En Russie, « Certains charmés, se déguisent de nouveau en imitant les costumes de l’Histoire. D’autres fuient, travestis eux aussi (…). Ceux qui, dans les fêtes d’autrefois, s’habillaient en mendiants mendient, couverts de haillons. Ceux qui jouaient aux fantômes ou aux chauves-souris se cachent dans les greniers, en épiant le bruit des talons ferrés. Ceux qui portaient la cagoule du bourreau deviennent bourreau ou, plus souvent, victimes… » (p. 161). Cependant qu’en France, dans les trains, les lecteurs s’extasient des descriptions minutieuses des pendaisons des condamnés de Nuremberg. « Le voisin d’Olga sortit en laissant son journal sur la banquette. Elle parcourut l’article. Dans un encadré, deux colonnes de chiffres indiquaient pour chacun des condamnés l’heure et la minute du début de la pendaison et celles de la mort. “C’est-à-dire le temps durant lequel ils se débattaient dans ce bretzel”, pensa Olga. Les chiffres lui rappelaient ceux, ennuyeux et sibyllins, des cours de la Bourse… » (p. 119). De la confrontation de l’Histoire russe et de l’Histoire française se dégage la grande passion de l’homme pour la violence dans un monde où l’on est toujours le bourreau ou la victime d’un autre.
L’amnésie qui suit le traumatisme historique fait tourner la roue des guerres. Qu’ont retenu les Russes de leur révolution, de Staline, du Goulag ? Qu’ont retenu les Français du colonialisme, du nazisme et de la déportation ? Au regard de l’actualité, où chez les uns la chasse aux noirs est devenue un sport national, pendant que chez les autres l’on ravive la hiérarchisation des races et où les ignobles se font généticiens, assurément pas grand-chose. Aux lendemains de la fin de la seconde guerre, des journalistes rapportent : « Romano Mussolini joue admirablement bien de la guitare. Le fils du Duce est un bon jeune homme qui a tout oublié du passé et qui voudrait que le monde entier en fît autant » (P. 125). Sans oublier, que ce qui est frappé du sceau de l’oubli est forcément reproduit, volontairement ou non ! Reste l’odeur nauséabonde du mal et d’une crucifixion sans cesse réactualisée : Olga « souffre plus de l’odeur acide de la croix en cuivre qui se détache du poitrail roux de son violeur et qu’elle sent se poser sur ses lèvres. Et aussi l’odeur aigre du grand corps sale » (p. 163). En effet, si l’Histoire est susceptible d’être l’objet de toutes les manipulations idéologiques, la mémoire, elle, est difficile à évincer. C’est en cela que ce que Ricœur nomme « la mémoire collective » peut s’avérer salvatrice dans le « train » du temps qui va à une allure folle alors que « quelque chose s’est déréglé dans cette grande demeure » (p. 80) qu’est la Russie.
Le conteur-détective, instructeur du dossier d’Olga, doit maintenant découvrir ce qui fait la force de cette mécanique historique. Comment « … perturber le bon sens de la routine humaine… » (p. 124) ? C’est là une question essentielle pour Andreï Makine. C’est à travers le personnage d’Olga, comme actrice et agente de l’Histoire, qu’il tente de trouver une réponse. Celle-ci restera enfouie. Nous ne la saurons pas. En revanche, la Princesse se console par les sagesses dont elle est inspirée : « Toutes ses pensées aboutiront à cette unique sagesse : le monde est le mal, un mal toujours plus astucieux que ce que l’homme peut supposer, et le bien est l’une de ces astuces » (p. 167). Quant à nos idéaux, ils ne se réalisent que dans l’expression de notre sauvagerie : « … la liberté dont ils ont tant rêvé est atteinte, absolue, dans cette ville en guerre. Elle pourrait prendre l’arme de ce soldat mort étendu près du mur, tuer le premier venu. Ou bien rallier les assaillants car ses haillons la rendent si proche d’eux » (p. 166). L’événement historique ressemble à une mascarade où chacun porte un masque, où l’on marche sur la tête comme l’indique le portrait de la grand-mère qui est renversé vers le bas par les invités.
Oui, souvent elle a l’impression que les bals costumés n’ont pas cessé et qu’à présent toute la Russie s’adonne à cette folie de déguisement. On ne sait plus qui est qui. Le grand vent libertaire les enivre. On peut tuer un ministre et se trouver acquitté. On peut insulter un policier, lui cracher au visage, il ne bougera pas[5].
La Russie est donc la demeure où les valeurs morales sont inversées, où l’anarchie dirige comme un chef d’orchestre. Olga, comme Makine, a beau chercher le « prestidigitateur » de notre Histoire, elle ne trouve jamais qui accuser alors que nous sommes tous des présumés coupables ou, pourquoi pas, des coupables confirmés.
Olga est donc la métaphore-métonymique de l’Histoire. Elle est le corps-mémoire, agent de notre horreur qui, faute de mieux, préfère se charger de tous les crimes[6]. Elle est celle qui veut oublier pour ressembler aux autres, alors qu’elle sait que tous les objets qui l’entourent sont chargés de mémoire. Si, dans ses délires, Olga dit avoir pratiqué « … un avortement clandestin » (p. 58), c’est pour mieux incorporer l’échec de la Libération à enfanter la paix, ce qui nous fait penser au « fœtus » qui hante La Répudiation de l’écrivain algérien Rachid Boudjedra. Là aussi, il s’agit de l’échec de l’Indépendance de l’Algérie à enfanter une nouvelle Histoire apaisée. En fait, il semble que l’Histoire soit dotée de sa propre force qui lui permet de transformer nos efforts, de changer notre quotidien en farce :
Trop tard car soudain l’Histoire semble en avoir assez de leurs déguisements et de leur prétention de changer son cours, d’accélérer sa marche. L’Histoire ou tout simplement la vie s’ébranle lourdement comme un grand fauve dérangé en plein sommeil et se met à broyer, dans un monstrueux va-et-vient de ses forces, tous ces homoncules capricieux, névrosés, embrouillés dans leurs réflexions stériles[7].
C’est dans la stérilité du monde que Olga cherche à récupérer sa propre vie. Cette femme résistant aux rôles que sa société lui assigne, qui s’accommode de la pauvreté alors que les siens la veulent capricieuse pour se venger de la société parisienne noble et hautaine, cette femme est en quête de sa propre individualité qu’elle entend vivre en équilibre avec sa personnalité et surtout d’un espace-temps qui lui assurerait la paix : « Olga ne vit pas le jour passer. Ou plutôt elle le passa dans les histoires de tous ces lecteurs qui la noyaient sous leurs paroles. “Ils m’ont chassée de ma propre vie”, se disait-elle avec rancœur » (p. 97). À subir l’Histoire, elle est devenue une « mater dolorosa » qui nargue le destin, non pas par un sourire comme le lui conseille son amie Li, mais par ses délires. En effet, Olga déstabilise le lecteur-auditeur par ses visions hallucinatoires qui passent pour réelles. Nous nous retrouvons comme les habitants de la Horde qui découvrent le noyé Goletz et la Princesse : « C’était d’ailleurs la sensation que tout le monde éprouva sur cette rive. Un malaise visuel, comme si un cil avait glissé sous la paupière et brouillé la vue » (p. 33). Le texte, lui, n’est pas linéaire. C’est un va-et-vient dans le temps, une interpénétration d’époques et d’histoires qui jettent le doute sur l’identité du narrateur et de l’auditeur car dès lors qu’on joue avec la mémoire, l’on rend difficile l’identification de l’Autre. Dans son acmé, le délire d’Olga nous propulse vers le temps où la rupture entre Dieu et ses créatures s’est renouvelée :
Devinant tout, ne comprenant encore rien, elle vit sous ses paupières s’assembler des fragments dispersés : ces doigts en voltige au-dessus des fleurs de houblon infusées, les trois photographies de la femme nue, la porte ouverte la nuit où elles avaient été prises, deux jours passés chez Li, l’avortement… Ses yeux noyés dans l’épaisseur cotonneuse du vertige discernaient déjà avec horreur le sens de cette mosaïque désassemblée. Mais la pensée, engourdie, par la montée du sang, se taisait[8].
Il est difficile de ne pas voir ici une référence aux tablettes brisées de Moïse. Olga se charge parfois de les ramasser et de les mettre en ordre pour lire la Vérité. Mais c’est le « crime », comme cri divisant, qui s’écrit, ce qui oblige la Princesse à retourner dans ses délires, à briser à son tour les tablettes : « Le brouillard se dissipait pourtant peu à peu, la mosaïque devenait de plus en plus irrémédiable. Ses fragments colorés rappelaient un gros reptile, d’un rouge foncé, qui s’enflait dans son cerveau » (p. 106). Olga Arbélina est le lieu où la vie sans avenir vient s’écraser pour un avant-goût de sa mort, où le passé vient rappeler son passage en ouvrant ses blessures. Elle est la passerelle actuelle qui permet le passage du mal historique de la Russie à la France, du passé à l’avenir : « …on mourrait à la Horde d’or comme partout ailleurs, on y grandissait et devenait vieux et toute une génération russe était née sur ce sol étranger, tous ces jeunes qui n’avaient jamais vu la Russie. Comme par exemple le fils d’Arbélina… » (p. 128). Tout cela nous fait penser que le crime dont s’accuse Olga Arbélina pourrait être d’assurer la pérennité d’un mal atavique, figuré par l’hémophilie de son fils dont « La transmission peut sauter une ou deux générations » (p. 132).
Le lecteur qui mène son enquête parallèlement à sa lecture en sort avec une question : Olga peut-elle vraiment être une criminelle ? C’est là que Andreï Makine réussit à en tromper plus d’un. Cela commence par le titre, jugement sans appel, qui nous oriente vers Le Crime d’Olga Arbélina. En vérité, l’enquête est celle menée par ceux qui se sont nommés la Horde d’or, et qu’on peut considérer comme une Horde de loups compréhensibles. Le récit qui nous est donné est une contre-enquête. D’ailleurs, le juge d’instruction apparaissant au début de l’œuvre dit : « C’est la première fois de ma vie que je dois convaincre une personne qu’elle n’a pas tué » (p. 47-48). Là est la nouveauté d’une œuvre qui adapte en partie les procédés d’un thriller. Face à l’impossibilité de changer le monde, Makine veut proposer une nouvelle écriture, qui serait « un nouveau regard sur la mort » et donc sur le monde, une écriture qui ne cherche plus les coupables, car trop nombreux, mais les rares innocents. Le jeune étudiant serait-il la figure de l’écrivain lui-même. Nous pouvons en effet suggérer une réponse positive à la lecture de ce passage :
… cet homme [le jeune étudiant], lui aussi, a entendu parler du “jardin où l’on découvre un autre regard sur la mort”. Il ressemble à celui qui, une demi-heure avant le déjeuner familial, lequel doit réunir une douzaine de parents, se lève, s’habille en hâte comme s’il était poursuivi et part sans prévenir personne, ce qui ne lui est encore jamais arrivé. C’est cette image qui le poursuit : les yeux, les bouches, les visages qui allaient l’entourer, en répétant les mêmes grimaces, les mêmes phrases que la dernière fois, en mâchant, en déglutissant[9].
L’auteur confirme sa volonté de proposer un nouveau genre d’écriture – rassemblant les hommes – qui ne « … parl[e] plus que ce langage à mi-chemin entre jurisprudence et roman policier, comme s’il y retrouvait le goût de sa nomenclature latine » (p. 38). La « nomenclature latine » revient plusieurs pages plus loin sous une autre forme qui souligne le besoin de communier autour du rêve d’une nouvelle littérature qui serait : « surtout un sujet passe-partout qui aboli[t] la frontière entre la ville haute et la ville basse, entre les groupes autrefois étanches et facilit[e] miraculeusement le rapprochement entre les inconnus » (p. 38). Nous insisterons aussi sur la référence précédente à la « jurisprudence », à une décision de justice innovante, allant à l’encontre de la loi traditionnelle, et qui peut servir dans d’autres procès. Pour ce qui est d’Olga Arbélina, l’Histoire est à sa décharge. Très tardivement, nous apprenons que le récit se déroule en 1947 alors qu’Olga est dans une chambre sur un « lit blanc », un hôpital psychiatrique ?, où elle délire sur son passé. On apprend que son mari est reparti en Russie avec son fils et Li attirés par les promesses de pardon de Staline. Le mari et Li perdront la vie en camp de rééducation alors que le fils disparaît. « Donc tout n’a été qu’un long songe tortueux et pénible » (p. 335).
La Vérité n’est pas dans l’identifié du récit, en l’occurrence Olga Arbélina, surtout que « Tout ce bouillonnement reposait en fait sur peu d’éléments matériels » (p. 38). Elle est chez les anonymes au milieu desquels elle vit mais aussi des anonymes qui lisent son histoire. Bref, la Vérité est dans notre Histoire dont la force destructrice nous accule à escompter une échappatoire par le biais de la littérature. L’innovation littéraire peut-elle aider à changer le cours du temps ? Andreï Makine semble croire que cela est possible et entend poser sa pierre à l’édifice de cette parole salvatrice. Le Crime d’Olga Arbélina appelle « le sens du sacrifice, [se sert de] l’art qui justifie tout, [pour dénoncer] l’égoïsme viscéral des hommes… » (p. 18). Nous faisons l’expérience de ces trois valeurs : en tant que lecteurs d’un men-songe, nous sacrifions notre temps, notre vie, pour activer notre imagination d’artistes cachés, et ainsi combattre cet égoïsme qui motive nos actions quotidiennes. Face à Olga, nous sommes le bois et le feu à la fois.
Ali Chibani
[1] Paris, éd. Mercure de France, 1998.
[2] Pour ce qui est du rapport entre l’œuvre et le lecteur nous conseillons : Emmanuelle Occelli : « Programmation et représentation dans la fabula du désir du lecteur », http://revel.unice.fr/cnarra/document.html
[3] Le Crime d’Olga Arbélina, op. cit., p. 55.
[4] Ibid., p. 42.
[5] Ibid., p. 158.
[6] En se chargeant de tous les crimes historiques, Olga prend figure de nouveau Christ se sacrifiant pour expier l’humanité.