D'eaux douces de Fabienne KANOR
Triptyque cruel sur un corps insulaire
Par Célia SADAI
Le mal de terre que d'aucuns s'amusaient à baptiser le complexe de l'Antillais mais qui ne tarderait pas à péter.
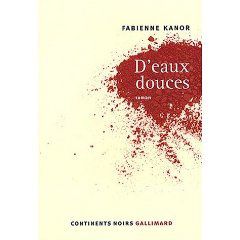
Avant de proposer toute lecture du roman de Fabienne Kanor, une question paraît inévitable : la littérature a-t-elle porté silencieusement les maux de la Caraïbe avant qu’ils n’explosent bruyamment aux yeux du monde – et du monde francophone ? Haïti, la République Dominicaine, Cuba… aujourd’hui les Antilles françaises, perdent de leur superbe – exotique – pour laisser surgir des brasiers de mots. La Caraïbe qui refoule, ravale, avorte et s’empêche de dire sa douleur, parle désormais, et affole certains.
Le roman de Fabienne Kanor cartographie la douleur. Le cri révolté des Guadeloupéens est le même cri entendu ailleurs, dans la Caraïbe. Laquelle est perçue par les protagonistes de Kanor comme « le sixième continent ». C’est ce cri caribéen, ce cri noir et insulaire que porte le roman D’eaux douces, paru en 2004. Quelques années plus tard, nous l’entendons enfin.
Et cette femme, que le maître emmène dans les cales ?
Le roman de Fabienne Kanor explore les deux motifs de la sexualité et de la féminité, rassemblés dans une image aussi symbolique que productive : le corps de la femme noire. A défaut d’un discours hérité d’aïeux – surtout marqués par leur absence, la narration explore la construction de l’identité sexuelle de la femme noire antillaise comme la matrice qui génère – par anthropomorphisme – une autopsie à cru du peuple antillais dans l’espace transatlantique. Ainsi, le récit que livre Frida se compose de paraboles dont chacune raconte, de manière triviale, lyrique ou brutale, le conflit de l’Antillais face à son existence et son essence supposée. C’est un réseau de réminiscences qui construit la narration : souvenirs refoulés, tabous familiaux et sociaux ; inceste, infanticide et viol ; désirs et fantasmes ; mensonge et humiliation… On hésite à recourir à l’éclairage biblique de la malédiction de Cham, qui fédère les écritures du tragique antillais. S’il y a du Chamoiseau, du Glissant, ou du Fanon chez Kanor, la lecture raciale et territoriale s’épaissit nécessairement de l’option féministe. A ce titre, le roman de Fabienne Kanor rappelle davantage celui de Gisèle Pineau, Mes quatre femmes, fédérant des thématiques propres à l’écriture féminine noire.
Ainsi, la narratrice Frida est membre actif du M.L.N, le mouvement des « négresses en voie d'émancipation ». Leur combat ? Assumer et revendiquer le droit au désir, au plaisir, et avec un Blanc de surcroît. La sexualité de la femme noire est en effet une affaire de « règlement prescriptif » raciste comme celui imposé à Frida par la communauté antillaise de la Cité Universitaire à Paris :
Peau couleur mango, cheveux grainés, traits négroïdes, accent parisien. Rien à déclarer. Frida appartient à l'espèce des Blacks, ceux qui se partagent les sixième et septième étages de la cité U, avec les Antillais fraîchement débarqués. […] ceux-là sont les maîtres du monde. Ils font la loi et entendent mettre au pas tous les Antillais de la cité. C'est ainsi qu'il est dit dans une charte [...] que les hommes blancs n'étant pas des citoyens recommandables, toute relation sexuelle avec l'un des leurs est jugée contre nature et passible d'une amende. [...] - Tu as oublié ce que les Blancs ont fait aux Noirs. Tu es l'enfant d'un viol, Frida, ne l'oublie jamais ! […] Les Juifs, les Chinois, et même dernièrement les Africains l'ont compris : une nation ne peut être forte que si ses membres s'unissent. Tu as déjà entendu parler de Farrakhan ?
A l’origine du désir charnel, il y a l’interdit prescrit par la race et par « obligation historique ». Devoir, trahison et lutte font de la sexualité un champ de bataille où règnent le paradoxe et la confusion. Pour Frida, la construction de son identité sexuelle ne peut dès lors s’affranchir du diktat des autres sur son propre corps et son désir. En aval du discours communautaire, il y a celui du père et de la mère, qui stigmatise l’homme noir et l’exclut des potentialités de la relation amoureuse :
Etre élevée dans la peur de l'homme noir génère des troubles de comportement provoquant chez la négrillonne devenue femme des réflexes d'autodéfense, une attitude de violence ainsi qu'une méfiance absolue à l'égard de tout sujet répondant de près ou de loin à la définition du nègre. Est nègre l'homme capable de coquer dix femmes à la minute. De fabriquer des mensonges cent fois plus gros que lui. De te voler ta vertu sans prendre de plaisir. Est nègre le dorlis, le chien savane. Est nègre l'homme qui te dit A et pense B. Qui te jure B et pense A. L'homme qui rement. L'homme qui repart. Qui disparaît sans scrupule. Revient sans commentaire. Est nègre celui qui te viole du regard. Te fait cinq gosses dans le dos. T'en fait voir de toutes les couleurs, te déclare que c'est lui l'homme et que tant que cela durera, le nègre durera.
Dans le roman, la violence qui altère fatalement l’image de l’homme noir – comme tout principe charnel – se justifie par le discours historique. L’Antillais n’est qu’une essence historique dont le point d’origine comme la destination converge vers l’impossibilité du « commerce triangulaire âme/sexe/cœur ». La faute aux fatalités de l’Histoire donc, puisque ce noir essentiel n’obéit qu’à ses peurs ataviques : « Il paraît que cette peur vient de loin, qu'elle remonte a la petite enfance, au temps ou flottaient les hommes, au bout d'une corde, avec des coups de fouet en guise de bénédiction. » Chez Kanor, les corps se sont retirés du monde, n’éprouvant des émotions que « parvenues des cales» :
J'ai pleuré au moment où sa voix [Billie Holiday interprétant Strange fruit] a marqué un temps d'arrêt entre strange et fruit, instant de silence sourd, abominable vide qu'avaient sans doute ressenti les nègres en voyant leurs frères morts, puants et pendus comme des bâtons de réglisse à des branches d'arbres.
L’obsession de Frida pour la tragédie de l’esclavage conditionne de facto sa propre expérience du monde. Son initiation à la sexualité recouvre le palimpseste violent de la Traversée. Si l’homme noir porte en lui cette peur qui le condamne à l’inconstance, l’identité sexuelle de la femme ne se construit que sous le sceau du viol originel de l’aïeule déportée :
Son petit corps gracile, coincé entre le bois et les peaux, happé, broyé. Il la voit, contrainte de se lever, rampant jusqu'au pont derrière un homme pressé que ses cris de douleur ont l'air d'amuser. - Chienne de négresse ! Je vais te montrer comment crier ! La haine. Ne pas pouvoir bouger. La honte. Supporter le viol. La revoilà, brisée, alors qu'on la croit morte. Coupée en quatre. Ecrabouillée. Silence. Que dire après cela ? [...] Je n'ai rien dit quand l'homme m'a fait asseoir par terre et m'a caressé la croupe. Quand il s'est mis à vociférer et à farcir ma tête de paroles. [...] Je crois bien que c'était la première fois que j'entendais le mot "négresse". La première fois aussi qu'on entrait dans ma chair, m'éclaboussait de sperme, me mettait à l'envers, à l'endroit, sur les côtés. A l'endroit, sur les côtés, à l'envers. La honte. Dissimuler mon corps violé. Mes tétons meurtris. Mes fesses mouillées. La peur. Redescendre dans les cales comme si de rien n'était...
Toutes les femmes du roman sont impunément trahies, violées ou humiliées. Les deux mouvements qui orchestrent cette dialectique des corps – la peur du fouet et la soumission volontaire – sont les signes symboliques qui construisent l’allégorie caribéenne. Dans le roman, Caribéens et Antillais souffrent du « mal de terre » dans un équilibre parfait et irréductible : la terre maudite n’engendre que le monstrueux. Il faut pourtant noter que le discours porté par Fabienne Kanor sur l’inconstance de l’homme noir a été aussi la base de l’émergence du « Black feminism » aux Etats-Unis durant le mouvement des Droits Civils dans les années 1970. Le topos géographique se radicalise donc pour laisser entendre la voix de la femme que le maître emmène dans les cales…
Le Domien est-il un immigré ?
Ou, si l’on opte pour l’ironie : le Français issu des départements d’Outre-Mer a-t-il sa place derrière les vitrines de la Cité de l’immigration et de l’identité nationale ? Frida raconte un roman familial tissé sur l’épopée amère de ses parents en métropole. Ce qui frappe, c'est que les motifs qui articulent le parcours des parents rappellent la configuration des récits d'immigration – et notamment ceux dont les immigrés sont issus d'une ancienne colonie française. Ainsi, si Frida porte en elle un tragique plus ancestral, tout dans l'attitude de ses parents et de l'environnement familial évoque une relation à la métropole à mi-chemin entre celles qui sont décrites par Frantz Fanon puis Albert Memmi.
Mû par un attrait sans borne pour la « Grande France », l'Antillais parvenu en métropole éprouve une autre « antillanité » proche de la « négropolitanité » et alimente les fables que se racontent ceux qui sont restés là-bas. C'est cette expérience commune qui rassemble Frida et son amant Eric dans le roman :
La même. Eric avait goûté à la même histoire, goûté à la colère créole d'une tante, croqué dans un fruit trop mûr tombé flagada d'un vieux pied mango. Comme Frida, il se rappelait aussi ses heures de gloire, ce jour du seigneur où son arrivée aux Antilles avait fait la une sinon le tour du quartier. Interrogé par tout un lot de cousins, il leur avait dessiné le Black de France, cet hyper négro sans papiers capable d'embrasser toutes les nationalités.
L'immigré domien traverse alors les mêmes étapes obligées : fantasmes de réussite dans une France idéalisée, déception puis perte du lien avec le pays natal, enfin, frustrations de l'entre-deux :
Images folles d'enfants sages débarqués dans la vie avec un conteneur de souvenirs. Pères et mères fonctionnaires, labellisés français depuis 1946 et heureux bénéficiaires du Bumidom, ce bureau conçu à l'attention des Antillais de France, ceux qui rêvaient de voir de près le pays, le Beau Pays-La France, auquel, au terme de bien des malheurs, on avait fini par les rattacher.
Comme l'immigré, l'archi-Antillais décrit par Kanor trouve sa place dans cette tension qui conditionne son existence : le départ pour la grande France, le retour au pays natal :
Dix ans de métropole creusent la distance qui sépare la terre ferme de l'île flottante. Dix ans de grande France usent. Nos parents soupirent et semblent avoir renoncé à l'idée de repartir. Pour autant, et pour se donner bonne conscience, ils font comme tout le monde et renouvellent chaque année leur demande de mutation. Un formulaire à remplir et quelques lignes suffisent pour exprimer le désir du retour au pays. S'ils ne sont pas exaucés, il arrive que le miracle se produise ailleurs ; une cousine mutée à Cayenne, un couple d'amis transbordés jusqu'à Basse-Terre après quelques années de bons et loyaux services administratifs. Se faire muter, être muté, décrocher sa mutation... C'est comme un refrain obsessionnel, un cancer à l'échelle d'un peuple, le rêve organisé de toute une diaspora. Dans la maison où vit Frida, la maladie s'appelle gangrène, ronge en silence le cœur des locataires. Du haut de ses huit ans, Frida les observe, penchés comme des petits vieux sur leur feuille, remplissant consciencieusement la partie réservée au fonctionnaire originaire des Dom. Rendez-vous l'année prochaine. Même mois, mêmes vœux, même formulaire.
En France, l' « immigré » antillais est aligné au rang des Blacks, venus d'Afrique ou de lointains archipels. Le motif de la couleur est exploité dans le roman sous le double paradigme honte/souillure. Ainsi, la mère de Frida rêve d'un univers aseptisé où ses filles, tirées à quatre épingles, feraient presque oublier leur couleur noir foncé. Comme pour conjurer le sort, elle frotte et bâtit le roman familial sur le complexe identitaire :
Il y a de la graisse sur le rebord de l'évier, une pâte molle et blanche qui rappelle le saindoux et la crème coco. Postée devant la glace, les coudes relevés, Frida se prépare au combat : la victoire de l'homme sur la nature, de la négresse sur ses cheveux crépus. Démêler, graisser, assouplir, diviser... Le geste est précis, séculaire. Aucun faux pas n'est permis. C'est ainsi. [...] Tandis que le peigne s'enfonce dans le noir, se fraie un chemin jusqu'au crâne, Frida se surprend à penser à maman. Mère aux cheveux tirés-défrisés, lisses comme le poil d'un manteau synthétique. Mère coquette qui ne comprend pas ce qu'elle a fait au bon Dieu pour avoir des filles au cheveu coco-sec. Qui met cela sur le compte de la déveine et prétend que cette déficience capillaire fait partie des mystères inexplicables de l'existence, aucune d'entre nous n'ayant hérité des cheveux longs, souples et raides de sa mère. [...] L'illusion d'un paradis perdu, jamais vu, jamais connu. Elle sue, Frida, refuse de baisser les bras, tord ses cheveux dans tous les sens. Oh hisse ! Le cheveu se lisse. Trois, quatre : il se met au pas. Elle connaît la loi, est capable de la réciter par cœur. Cette bible du cheveu noir qui contient autant de commandements que de pratiquantes. Tu devras les laver tous les jours. Les graisser matin et soir. Les tremper dans du lait de vache. Les enduire deux ou trois fois par mois de moelle de bœuf. Tu ne devras pas prendre de bain de mer, ni de soleil, ni de rivière. Eviter le henné, l'ammoniaque, l'huile de coco et cætera de produits recommandés par la sagesse populaire et décriés par les scientifiques. Le cheveu noir, c'est toute une affaire, ma fille, un dossier éminemment sérieux. Et puis il y a l'horreur, le comble, l'erreur suprême qui consiste à te couper les cheveux. Couper tes cheveux ! Les abandonner à leur triste sort, perdre la foi en ces lendemains meilleurs. Les couper comme pour signifier que tu as cessé de lutter, que tu t'es rendue à l'évidence : tu es noire, noire-bleue, Kongo. Une négresse qui se fiche pas mal du métissage a cessé de secouer l'arbre de ses ancêtres pour en faire tomber un Blanc.
Une peau sans couleur... la fable de Ralph Ellison (Invisible man) anime d'autres personnages du roman, comme Eric, qui confesse comme un alibi un sentiment ambigu d'appartenance au monde global :
Je suis né dans une maison de poupées russes. Un domicile fixe où chaque objet enferme son double, chaque face son envers. C'est là que j'ai grandi, avec des tonnes de vérités et dans un tissu de mensonges. Etre un bon Blanc et un vrai nègre. C'est ce que les miens m'ont inculqué. Guadeloupéen ? Disons plutôt citoyen du monde... Oui, c'est cela. J'aime cette idée d'appartenir à tous les pays, de n'avoir pas, où que j'aille, à brandir comme un étendard la carte de la Guadeloupe. Il m'est d'ailleurs souvent arrivé de penser que j'aurais pu naître ailleurs. Tu ne verras jamais quelqu'un danser la salsa, chanter du compas et te parler de New York avec autant de ferveur qu'un Antillais. Les gens d'ici sont comme cela, ils ont tendance à admirer tout ce qui vient de l'extérieur. [...] Suis-je à mon tour devenu cet homme ? Cet Antillais bourré de complexes, incapable de regarder en face les mornes de son île, les femmes de sa cité, les richesses de sa terre ?
Des émeutes dans les banlieues de métropole à celles, plus récentes, qui ont enflammé la Guadeloupe, il n'y a qu'un même reflet au miroir : celui du passé impérial et colonial de la France. Les littératures francophones postcoloniales sont-elles dès lors condamnées à ressasser cette dégénérescence de l'identité nationale, transnationale et culturelle, empruntant les territoires du réalisme jusqu'à l’usure ?
Cartographier la douleur : le Sixième continent à la dérive
La névrose qui habite les protagonistes de D’eaux douces contamine l’ensemble du paradigme identitaire : identité nationale et transnationale, sexuelle, culturelle. Polymorphe, cette névrose se traduit sous plusieurs symptômes : folie (l’« hystéro-épilepsie antillaise »), oubli léthargique et pulsions meurtrières, tels sont les affects qui abîment les esprits et altèrent – par anthropomorphisme – le corps insulaire. Qui es-tu négropolitaine ? C’est la question assassine que pose la Tante à la mère de Frida, venue passer ses vacances de « fonctionnaire domienne » en Martinique :
- Islam ! Coulie-coq ! Les injures tombent dru dans l'arène, interrompues net par le massacre de Tantie L'Embrouille, inerte, sur le sol, les deux fers en l'air. Prise d'une tremblade infernale, notre tante prend le maquis direction l'hôpital Colson, où, après avoir diagnostiqué une hystéro-épilepsie, on conclut à un cas de folie ordinaire d'une fille de Cham. D'après le médecin, diplômé en psychiatrie expérimentale et qui ne jure que par Frantz Fanon et Tobie Nathan, l'Antillais serait particulièrement prédisposé au délire, lequel se manifesterait de diverses façons et affecterait considérablement le rapport du sujet à la réalité. - Etre arrière-petit-fils d'esclaves n'arrange pas les choses, ajoute ma mère, prise en flagrant délit de paranoïa. Question : sachant que les hallucinations relèvent du délire, quelle fonction assigner aux soucougnous, manmans dlo et autres espèces semi-végétales du surréel antillais ? [...] Ils pullulaient, ceux dont la raison avait fini, faute de place, par fiche le camp, grappes d'âmes errantes transportées dans de trop fines enveloppes. [...] [Frida] dénombre sur l'île, en juillet-août 1980, deux cent soixante-seize mille trois cent dix-sept fous.
Les Antillais de métropole ou de Martinique convoqués dans le roman existent tous en dehors d’une certaine forme de conscience du monde. Leur univers se partage entre les trivialités des « maquerelles », et des pratiques magiques inquiétantes. Dans ce repli, il est impossible de bâtir une conscience politique du monde qui conditionnerait engagement et révolte :
Je suis née chez des gens où l'on ne prend pas position, où le fait de donner son avis est considéré comme une marque évidente d'impolitesse. J'ai grandi avec cette peur de dire. La frousse d'ouvrir sa bouche. L'angoisse des représailles. C'est ainsi que j'ai été éduquée. Je ne fais pas partie de ce monde, flotte six pieds au-dessus, le regard figé, arrêté sur un passé devenu au fil du temps de plus en plus inconfortable. Je connais la lâcheté, aime son goût, son odeur, en ai mangé tous les jours depuis ma naissance. Elle est bonne cette lâcheté, me fait du bien, prend le chemin de mes intestins, se mange sans fin, se digère bien. Je suis née dans une maison où l'on ne vit pas. Où l'on consacre toute son attention, son énergie et son argent à mettre ses tripes en conserve. [...] Je suis née dans une cave sans escalier, un caniveau sans ouverture, un ventre sans cul, un jour sans soleil. Je suis née, mais n'existe pas. [...].
Ainsi, tout se passe comme si les figures d'Aimé Césaire ou de Toussaint Louverture étaient les symboles culturels dont n’hériterait qu’une intelligentsia privilégiée. Frida accuse la grande absente, l’Histoire caribéenne – et de la Diaspora noire, effacée des manuels scolaires – rendue muette pour mieux soumettre les désirs :
Au temps où elle n'était pas encore née, Frida se souvient que sa mère riait. […] Elle n'a jamais eu le blues, maman, n'a jamais eu mal à son histoire. Son école à elle n'était pas un lieu où l'on enseigne le savoir, juste un espace de transition entre le bourg et la maison. C'était l'école des Blancs, la ou des maîtresses noires roulant des r et des hanches apprenaient le bon français et la grande Histoire-France. L’institutrice de cours moyen était une chabine, une grosse dame mal élevée qui suait sous les bras mais que les gens de là-bas admiraient, rapport à son excellent niveau en français. [...] L'école des chiens savants qui ne se rappelait plus l'origine du monde. Les a-t-elle seulement entendues, maman, ces cales qui grincent au moindre coup de fouet de l’eau ? Les a-t-elle un jour senties, ces chaînes autour du cou, des bras, et du ventre ? Sourde de mère qui se déclare saine et sauve, lutte à sa manière pour la protection de son environnement personnel. Répond joker quand mes questions la tenaillent, la prient de répondre, résonnent dans la nuit sans lumière. [...] Au temps où ses jambes ne la portaient pas encore, elle se rappelle aussi les paroles de sa mère, muette d'admiration devant un enfant à la peau jaune et aux cheveux couleur épi. Des années à voir suer sa mère, démêler furieusement les cheveux de ses filles, pester contre cette brousse qui jouait avec les dents du peigne, à faire driling driling. Maman, petite mère. Négresse salon, W-C, chambre, douche, salle à manger. Qui a su se battre contre les cheveux et a négligé le reste.
Kanor active ici ce qui est devenu un lieu commun des écritures francophones : l’effacement de l’Histoire, et la réinvention nécessaire d’une parole historique. Cette parole, qui s’exprime sous autant de modalités que peut en produire la fiction littéraire, s’articule sensuellement autour du couple Frida-Eric. Leur union, aussi charnelle que spirituelle, perçoit les silences de l’Histoire comme des potentialités – des désirs à satisfaire en duo : « Je tourne en rond, et retourne dans tous les sens l'histoire de ces négresses tête basse, seins perchés, ventres souillés par le jus amer. Si et seulement si leurs cuisses ne s'étaient pas ouvertes, si et seulement si la mer avait avalé les gros négriers, si et seulement si les marins n'avaient jamais vu la terre... [...] Eric ô... Apprenons à faire sans. Taillons-nous une place dans la glaise pour y forger une nouvelle humanité. » Le couple agit comme par compensation et réparation de l’amnésie des parents. Eric est « l'homme-terre » : « Un homme de sable et d'eau, une ombre en terre glaise », et Frida est la « femme-mémoire » : « [Eric] a besoin d'une sœur, d'une fille-fleur aux racines si fragiles, un corps qui tremble au moindre sursaut de l'histoire, court, trébuche à la recherche de sa mémoire. » A mesure que Frida s’identifie aux figures tragiques du passé, sa colère nourrit une haine croissante vis-à-vis de sa mère. La mère est en effet celle qui colporte des prescriptions confuses sur la race, qui transmet l’ignorance et la léthargie politique, celle qui s’est prostituée… : « L'envie de pousser maman sur la chaussée, de lui faire un croche-patte, de la voir se vautrer, les quatre fers en l'air, comme une truie prête à consommer. J'ai envie de cracher sur maman. Salir son chemisier qu'elle a pris soin de repasser. » C’est la mère qui lui transmet le « mal de terre » qui la ronge… Cette mère est un double-principe allégorique qui porte en elle les contradictions d’une génération d’Antillais, mais se révèle aussi comme l’allégorie d’une mère-patrie qui n’a pas su protéger sa filiation… Quelle patrie Kanor accuse-t-elle ?
Le voyage de Frida et Eric en Haïti va altérer la foi que le couple porte aux vertus réparatrices du discours historique. Fabienne Kanor exploite le motif de la statue héroïque et de sa souillure par l'usure du temps ; topos du récit descriptif qui dénonce les trahisons de l’Histoire :
Avant de quitter le territoire, je trouve le courage d'aller saluer l'autre héros national : la statue du nègre marron sculptée dans du bronze et qui, dit-on, contient toutes les espérances du peuple haïtien. Parvenue sur le site, une place ouverte aux quatre vents, je ne puis retenir mes larmes. Il ne reste rien de la grandeur du nègre d'antan. A peine plus haute qu'un géant, la statue a perdu la mémoire, rouillée par les eaux et tapissée de crottes d'oiseaux. Jamais nous ne nous sentirons aussi éloignés de notre histoire. Découvrir que l'on s'est trompé sur un pays est presque aussi douloureux que de se sentir trahi par un proche. Le choc est encore plus violent dans le cas d'une île comme Haïti élue par l'histoire première République noire. Devant ce nègre marron de pacotille, Frida et Eric s'interrogeaient. Où état donc passée l'Haïti chérie de Toto Bisainthe, l’île-désirs de Depestre, la terre-mystère d’Alexis ? [...] De retour chez les nôtres, nous devons surmonter l'abominable épreuve du récit de voyage. - Et la citadelle, et les sacrifices vaudous, et les assassinats en pleine rue... Et la famine, j’ai failli l'oublier celle-là ! Les Haïtiens mangent-ils des racines ? Est-ce vrai, ce qu'on lit dans les journaux ? En silence, nous nous contentons de distribuer les cadeaux, n'évoquons que notre tourista et omettons de faire développer les photos.
Dès lors, et pour éviter un pessimisme fataliste, il ne reste d’autre option que la lutte par l’action :
Au centre de l'arène, un petit homme s'était accaparé le micro. - Antillais, Antillaises, voici venu le temps de la victoire de l'homme noir sur l'histoire. L'heure a sonné, nous devons récupérer tout ce dont nous avons été spoliés. Pas de devoir de mémoire sans dommages et intérêts ! Comme elle l'a fait pour le peuple juif, il est temps que la France reconnaisse ses erreurs et en paie les conséquences. N'écoutez pas ceux qui vous diront que le passé appartient au passé, il est plus que présent, au contraire, et nous allons prouver en organisant une grande marche nationale et en exigeant de l'Etat français un remboursement immédiat de ses dettes. […] nous ne reculerons pas et montrerons à la face du monde que nous sommes bien ce sixième continent avec lequel il va falloir compter désormais ! [...] A Paris, on comptait de plus en plus de manifestations de cet ordre, qui laissaient augurer l'émergence d'une vraie conscience politique. Si tous les Antillais, aujourd'hui, n'étaient pas prêts à y souscrire, viendrait le jour, il en était sûr, où ils forgeraient tous autant qu'ils étaient une vraie nation avec, pour dirigeants, des hommes et des femmes de combat et de bonne volonté. [...] Pour Eric et ses frères, il n'y a que l'indépendance qui vaille, la séparation définitive d'avec la mère patricide. [...] Préférant la misère matérielle à l'assimilation, la fratrie entreprend de dresser un listing, le plus complet possible, de toutes les étapes que l'Antillais aura à traverser pour retrouver sa dignité et son statut d'homme libre. Les plus extrémistes ne vont pas par quatre chemins, réclament que soit créée, à l'intérieur de même de l'Hexagone, une île : l'île de France, dont la superficie devra être équivalente à celle de la Guadeloupe et de la Martinique réunies.
L’action révolutionnaire et la protestation donc. C’est aujourd’hui que l’utopie prend corps, pour le salut du « sixième continent »… Pourtant l’allégorie politique de Fabienne Kanor est tendancieuse. La clôture du roman se compose des « Lettres du Blanc », celui qui a aimé l’aïeule de Frida, déportée durant la Traversée. L’enfant qui naît de leur union sera jeté dans l’Atlantique, donné en sacrifice au nom de la suprématie de la race. Dès lors, s’il y a eu un amour du « temps des cales », quel objet défend le roman : la révolte ou le pardon ?
Tout se passe comme si les acteurs du roman de Kanor ne parvenaient jamais à saisir le monde de manière immédiate, emprisonnés dans une grammaire funeste. Frida assassine Eric car elle souffre de cette névrose qui alimente sa haine de l’homme noir ; pourtant le meurtre ne résout rien et elle est finalement vaincue par ses pulsions. Le roman s’achève sans aucune proposition : la narratrice aurait-elle fait fausse route ?
L’échec constitutif des vies construites dans le roman déploie surtout un regard méfiant envers le monde noir. Pour le salut des protagonistes, il aurait sans doute fallut renoncer à un des nombreux systèmes prescriptifs établis par l’Histoire des idées pour illustrer, défendre ou accuser la « cause noire » - ces mêmes systèmes qui alimentent leur difficulté d’être soi au monde.



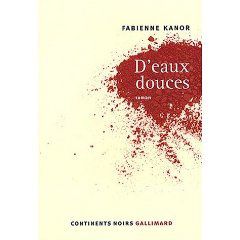

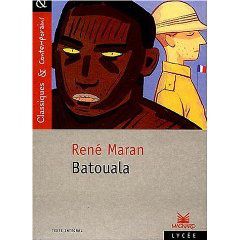 Batouala, souvent considéré comme le premier roman de la Négritude, a valu à son auteur martiniquais, René Maran, le prix Goncourt en 1921. René Maran est né en Martinique de parents guyanais. Il a été formé dans les meilleurs lycées de France et est devenu fonctionnaire de l’administration coloniale. Sous-titré « véritable roman nègre », Batouala décrit et dénonce la colonisation en Oubangui-Chari (ancien nom de la République Centrafricaine). Il y aurait beaucoup d'éléments à analyser dans Batouala, grand livre d’amour et de fureur – notamment la dimension lyrique de l’œuvre, la nature comme actant du récit, ou encore la question des... Pour lire la suite de cet article sur notre nouveau blog, cliquer
Batouala, souvent considéré comme le premier roman de la Négritude, a valu à son auteur martiniquais, René Maran, le prix Goncourt en 1921. René Maran est né en Martinique de parents guyanais. Il a été formé dans les meilleurs lycées de France et est devenu fonctionnaire de l’administration coloniale. Sous-titré « véritable roman nègre », Batouala décrit et dénonce la colonisation en Oubangui-Chari (ancien nom de la République Centrafricaine). Il y aurait beaucoup d'éléments à analyser dans Batouala, grand livre d’amour et de fureur – notamment la dimension lyrique de l’œuvre, la nature comme actant du récit, ou encore la question des... Pour lire la suite de cet article sur notre nouveau blog, cliquer