« Est-ce que la patrie, c’est l’endroit où l’on n’est pas ?… »[1]
Par Camille Bossuet
Berkane, immigré algérien de 45 ans, envisage l’avenir sous la forme d’un retour. Séparé de son amie française, il décide de rejoindre sa terre natale et, avant de retrouver la Casbah de l’enfance, s’installe sur la côte, en marge de la capitale, retiré. « Pré-retraité » de France, Berkane écoute le calme nouveau autour de lui, laissant ressurgir intérieurement la voix maternelle, dans le dialecte de la Casbah d’Alger.
Chez Assia Djebar, le temps du récit est malléable, il se dissipe entre souvenir et histoire ; la langue, dans un geste similaire, oscille entre parole et écriture. Pour Berkane, le retour au pays après vingt ans d’absence symbolise un espace offert, la promesse de commencer à écrire.
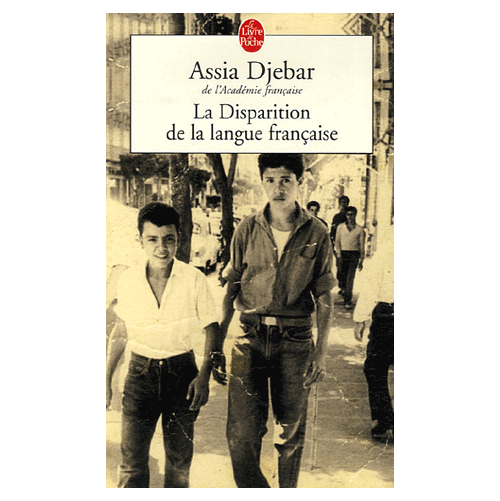
Nœud des langues
Dans ce retour décidé comme avenir, le premier mouvement d’écriture est celui de la correspondance. Dans la solitude de la maison de bord de mer, Berkane vit l’absence de l’aimée, la compagne française éloignée : Marise, qu’il appelle désormais « l’absente ». Les mots viennent en recours à l’attente du corps de l’autre, rappelant les étreintes, les « r » roulés, les « parlers accouplés[2] ». Le retour s’inscrit ainsi d’emblée dans un double enjeu : l’absence d’un corps aimé et l’approche d’une langue enfouie. Ces deux « terres », de la langue et de l’amour, s’interpénètrent ; un métissage qui interpelle Berkane : « Pourquoi s’entrecroisent en moi, chaque nuit, et le désir de toi et le plaisir de retrouver mes sons d’autrefois, mon dialecte sain et sauf et qui lentement se déplie, se revivifie au risque d’effacer ta présence nocturne, de me faire accepter ton absence?[3] »
Tandis que les conversations avec Rachid, un voisin pêcheur, font ressurgir le rythme de la parole dialectale, en langue française, les lettres à l’absente restées non cachetées jouent un rôle déclencheur. Elles sont les premiers écrits de Berkane. Cette première partie du roman voit s’alterner le « il » et le « je » narratifs : ce choix stylistique fait écho à l’ambivalence vécue par le personnage, l’entre-deux propre à l’expérience de l’exil et du retour.
L’entrée en écriture de Berkane est progressive, et, comme l’entreprise du retour, se donne à vivre comme cheminement, approche patiente, afin de se sentir « retrouvé ».
Je n’en reviens pas d’être là ; de retour. Vraiment ? « Je suis tout à fait là ? » La voix qui interroge en moi vogue des mots français à ceux de ma mère ‑ celle-ci, pour toujours, assise dans son humble patio de la maison d’enfance, rue Bleue, à la Casbah‑, elle vacille, hésite d’une langue à l’autre, d’un rire à l’autre : ma mère en moi s’étonne, ses yeux m’interrogeant…
Détours
Le brouillage intérieur que provoque l’arrivée sur la terre natale invite Berkane à prendre des chemins de traverse, guidé par l’inconscient : « le petit garçon, ressuscité, qui a peur de ce retour au pays natal…[4] ». Il faut reprendre depuis l’enfance, c’est-à-dire depuis la renaissance d’un drapeau vert et blanc, découvert à l’âge de six ans, dès 1952 ! Rachid, la trentaine, n’a pas vécu la guerre d’indépendance. C’est avec respect et fascination qu’il écoute la narration de Berkane, les anecdotes de son enfance, traçant en filigrane la chronologie du mouvement pour l’indépendance algérien, de 1952 à 1962.
La visite du quartier d’enfance, attendue comme « véritable retour[5] » par le narrateur exalté, ne se livre cependant qu’en demi-teinte : la réalité de l’an 1991 semble refuser le dialogue avec le souvenir. Devant le désarroi de Berkane, l’ami algérois s’exclame : « Ils t’ont pris pour un coopérant, un riche touriste[6] ». L’avenir, pétri de souvenirs d’enfance, piétine. Le trajet du retour est celui du nord vers le sud, de l’Europe opulente vers un pays fragile, à l’architecture délabrée, à la population désœuvrée. Le spectacle est difficile, désolant. Face à une société changée, muée, Berkane comprend l’impossibilité du retour, du moins dans son acception brute, à la fois géographique et temporelle. Désorienté, il vit « les retrouvailles (…) irrémédiablement fissurées, partant à la dérive, comme un paquebot qui se pencherait juste avant de s’enfoncer.[7] »
La perte définitive du royaume de l’enfance porte le personnage à l’écriture, par la nécessité de dire ce trompe-l’œil, cette illusion de l’exilé qui croit laisser derrière lui une image immobile : « Quoi de plus banal, la vie des lieux, des gens ‑ je le croyais ‑ resterait jaillissante derrière moi, donc en moi aussi ‑ moi m’étant cru momentanément le séparé, l’éloigné[8]. »
L’épreuve de lucidité vécue par Berkane lui fait perdre un temps la fluidité des langues, attendant une deuxième tentative, seconde rencontre avec les lieux, pour que le passé, « lourd et léger, reflue d’un coup[9] ».
Voix et récit
L’ouvrage de Djebar adopte le récit par mises en abyme : en partie mise en scène, la narration se rappelle à une forme orale. Chaque fois la parole est invitée, celle des femmes notamment. Nadjia est celle qui pénètre le territoire de solitude de Berkane, et qui entre à son tour en récit : « Cela fait des années que j’ai quitté ce pays […] Chaque fois que je dois rentrer […] je retrouve toujours comme une colère en moi.[10] » A travers elle, la mère, la grand-mère, toutes les femmes de la maisonnée d’enfance de Nadjia prennent voix.
Berkane devient scribe pour l’histoire de cette autre immigrée. Né à l’écriture par sa propre expérience d’absence puis de souvenir, il s’éprend de la parole de l’interlocutrice et la transcrit, faisant de la langue de la confidence, de l’intime, définitivement du côté du corps, de l’arabe algérien du tutoiement, une inscription en français : Je reconstitue, je me ressouviens de Nadjia, de sa voix qui remémore : je saisis, j’encercle son récit, sa mémoire dévidée, en mots arabes, que j’inscris, moi, en mots français (…)[11]»
Migrations des langues : retours ou disparitions ?
La circulation des langues est bien au cœur de l’ouvrage. Le retour en Algérie, pays polyglotte, rend prégnant le partage entre une langue charnelle, érotique, amoureuse et une langue politique ou humaniste. Le français est adopté comme « langue de mémoire[12] » par Berkane, qui entreprend le récit de son adolescence.
Deux ans ont passé. En 1993, l’Algérie voit fuir ses intellectuels francophones vers le Québec et la France. Berkane, de son côté, poursuivant sa quête en terre de retour vient à disparaître. A Alger, son frère journaliste, habité par sa disparition et empêché d’écrire, tente de survivre à la terreur des « barbus ». Nadjia, traductrice apatride, fait quant à elle le choix de Padoue, comme terre d’accueil féminine, et le texte d’Erasme comme guide.
De Paris, Marise se rappelle la fuite des Morisques andalous et des Juifs de Grenade après 1492, emportant avec eux la langue arabe, et questionne l’avenir des langues en terre algérienne : « Est-ce que soudain c’était la langue française qui allait disparaître « là-bas » ?[13] »
La finesse d’écriture fait se mêler les voix et les langues, entités liées, prises mêlées de temps, d’émotion, de territoire. Chacun des ouvrages d’Assia Djebar semble ainsi prolonger une fouille, un prélèvement minutieux au cœur de flux linguistiques, géographiques, temporels, afin de travailler cette matière et d’y laisser se dessiner des figures, au plus juste, d’identité.
[1] Mathide, dans Le Retour au désert, de Bernard-Marie Koltès. (Citation en exergue à la troisième partie, LDLF p.181)
[2] La Disparition de la langue française, Assia Djebar, Albin Michel, Paris, 2003, Le Livre de Poche, p.25. Voir notre dossier "Mémoire" dans Vaste est la prison du même auteur.
[3] Ibid., p.25.
[4] Ibid., p.22.
[5] Ibid., p.53.
[6] Ibid., p.59.
[7] Ibid., p.67.
[8] Ibid., p.65.
[9] Ibid., p.72.
[10] Ibid., p.85.
[11] Ibid., p.94.
[12] Ibid., p.186.
[13] Ibid., p.199.
commenter cet article …




 Bled Number One est le deuxième film de Rabah Ameur Zaïmeche, réalisé en 2006 après Wesh, wesh, qu’est-ce qui se passe ? (2002). En 2008, est sorti le troisième film du réalisateur, Dernier Maquis.
Bled Number One est le deuxième film de Rabah Ameur Zaïmeche, réalisé en 2006 après Wesh, wesh, qu’est-ce qui se passe ? (2002). En 2008, est sorti le troisième film du réalisateur, Dernier Maquis. « Nègr
« Nègr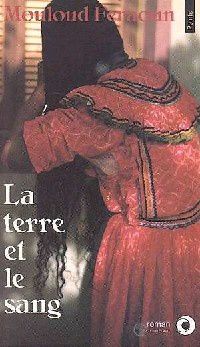 Dans La Terre et le Sang
Dans La Terre et le Sang