 Leïla Sebbar : une littérature pour tous
Leïla Sebbar : une littérature pour tous
Si Leïla Sebbar n’est pas une auteure pour la jeunesse, dans le sens où nous l’entendons généralement, la lecture de plusieurs de ses romans et nouvelles trouve néanmoins une résonance dans un large lectorat.
Née en Algérie pendant la colonisation, de père algérien et de mère française, elle part vivre en France pendant l’adolescence et ne cessera alors plus de réfléchir, à travers l’écriture, sur les liens qui unissent ses deux pays, ses deux parties d’elle-même.
À travers ce travail de mémoire et de construction identitaire, Leïla Sebbar, parle souvent de l’enfance, ce moment fondateur qui construit ou détruit l’adulte en devenir. Son écriture s’adresse ainsi à tout jeune lecteur qui saura être sensible à ces questions à la fois singulières et universelles et encore plus ces adolescents issus de l’immigration qui retrouvent dans ses récits leur propre histoire, leur double culture, et essaient de se créer face à elle.
Malheureusement, force est de constater que ses textes sont très peu connus du jeune public notamment car ils sont peu enseignés dans les écoles, les professeurs eux-mêmes ayant encore peu d’outils pédagogiques afin d’enseigner les littératures francophones contemporaines .
C’est pourquoi, en amont d’un travail approfondi sur l’oeuvre de Leïla Sebbar, nous proposons une petite présentation de quelques textes à faire découvrir aux adolescents et aux plus grands :
Tout d’abord deux recueils de nouvelles : La jeune fille au balcon (Editions du Seuil, coll. Points Virgule, 2001) et Soldats (Edition du Seuil, coll. Fictions, 1999). Le premier recueil alterne les deux lieux de narration que sont l’Algérie et la France et s’attache à montrer les liens qu’entretiennent les enfants d’immigrés avec les autres à travers le prisme des deux cultures. Des rencontres à la fois difficiles et enrichissantes. Les sept récits du second recueil parlent, quant à eux, d’enfants guerriers projetés dans une situation qu’ils n’ont pas choisi et qu’ils ne maîtrisent pas étant confrontés à tous les malheurs qu’entraîne la guerre : mort, exode, famine, etc.
D’une approche plus historique, La Seine était rouge, Paris, octobre 1961 (Editions Thierry Magnier) revient sur le massacre du 17 octobre 1961[1] à travers le personnage d’une jeune étudiante, Amel, qui ne comprend pas le silence de ses proches qui refusent de lui parler de ce qui s’est passé, alors qu’ils acceptent de se confier à un cinéaste réalisant un documentaire sur le sujet. Nous retrouvons ici la thématique première de l’écriture de Leïla Sebbar qui est la parole, ou plutôt le manque de parole. Tout son travail de mémoire part de ces non-dits, le plus souvent liés à l’exil, à une amnésie aussi bien politique, historique que culturelle.
La complexité de cette mémoire recherchée s’illustre aussi dans le récit documentaire, J’étais enfant en Algérie : juin 1962 (Editions du Sorbier, coll. J’étais enfant, 1997) où un enfant pris dans la tourmente, à la fin de la guerre, se questionne et s’inquiète sur la déchirure et la séparation qu’entraîne le départ des colons vers la France.
Leïla Sebbar s’attache également à suivre le parcours d’une adolescente à travers une série de trois récits d’aventures. Le premier, Shérazade, 17 ans, brune, frisée, les yeux verts (Editions Stock, 1982) retrace, dans un registre à la fois drôle, extravagant et réaliste, les dérives d’une fugueuse de banlieue et ses rencontres dans Paris. Cette jeune fille insoumise erre dans la ville (un de ses de squats préférés étant les bibliothèques) et côtoie les univers les plus sombres (drogue, prostitution) à la recherche de son identité et de sa liberté. Ses aventures se poursuivent avec Les carnets de Shérazade (même éditeur, 1985) où elle trace à travers la France sa propre géographie lyrique et amoureuse et invente, au fil de ses cahiers, une terre nouvelle à la croisée de l’Occident et de l’Orient. Enfin, Le fou de Shérazade (même éditeur, 1991) narre la quête de Julien, qui depuis sa rencontre avec Shérazade à Paris, ne pense plus qu’à la retrouver même si cela implique de parcourir le monde entier.
Pour terminer cette présentation et souligner le travail collectif de l’auteure, évoquons les deux recueils de récits qu’elle a dirigés. Une enfance algérienne (Editions Gallimard, coll. Folio, 1997) où seize écrivains nés en Algérie avant l’Indépendance racontent des bribes de leur enfance et les regards qu’ils portaient alors sur leur histoire. Dans la même optique, Une enfance d’ailleurs (Editions J’ai lu, 2002) réunit des auteurs nés et élevés dans un pays autre que la France mais y vivant aujourd’hui qui relatent un moment singulier ou des fragments de leur enfance étrangère. Encore une fois, ces histoires contribuent à montrer aux jeunes toute la richesse de la double culture et l’intérêt d’une dynamique mémorielle afin de mieux se construire.
Jessica FALOT
[1] Le Massacre du 17 octobre 1961 désigne la répression qui a frappé une manifestation pacifique en faveur de l’Indépendance de l’Algérie en France. Selon les estimations, entre 32 et 325 Maghrébins sont morts sous les coups de la police française, alors dirigée par le préfet de police Maurice Papon. Des dizaines de manifestants ont été jetés dans la Seine, tandis que d’autres sont morts dans des centres de détention. Nié par les autorités de l’époque, le massacre n’a été reconnu officiellement que le 17 octobre 2001 par le maire de Paris, Bertrand Delanoë.




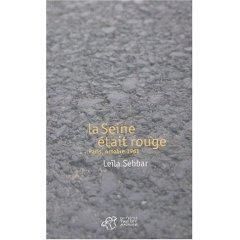
 Les Femmes au bain ou une écriture du mélange et de la brume
Les Femmes au bain ou une écriture du mélange et de la brume