Analyse
LA MORT DANS L’ÂME
Par Ali Chibani
« Je dus revenir à l’animal et à nouveau manger de la viande »
Maciej Niemiec, Le Quatrième roi mage raconte
« L’arme douce », c’est ainsi qu’on a désormais tendance à désigner le viol en temps de guerre. Cette façon de percevoir les choses est, certes, abjecte, mais elle ne peut être sans nous interpeller sur le tabou qui frappe encore ce qui est devenu un crime contre l’humanité : faut-il le nommer ? Et si oui, comment et par qui ? Faut-il distinguer violences sexuelles en temps de guerre et violences sexuelles en d’autres circonstances ? Ce sont là quelques questions qu’on peut se poser bien qu’en réalité et dans tous les cas on soit loin du compte. Il semble, à travers l’épithète « douce », qu’on se fait difficilement à l’idée que la sexualité ne soit plus le fait de l’amour mais de la haine car il est une réalité qu’on n’accepte que très difficilement, notamment l’acte sexuel comme acte de violence.
Les violences sexuelles sont devenues dans les pays en guerre une arme systématique des plus destructrices. Elle vise moins la satisfaction d’une pulsion par tous les moyens, même les plus criminels, que la destruction de la (future) femme comme lieu de vie et élément essentiel de la cohésion sociale. L’exercice de la violence sexuelle en temps de guerre vise donc « la féminité » et non la femme en tant que corps même si l’atteinte du premier passe forcément par la seconde. C’est sans doute pour cela que les violeurs, dans ce cas, considèrent rarement l’âge ou la constitution physique de leurs victimes. Qu’elle ait dix ou soixante-dix ans, cela importe très peu tant qu’elle représente l’ennemi et une occasion de le vaincre sans l’affronter. La victoire ici va plus loin qu’une victoire dans un champ de bataille car on s’approprie l’origine et l’identité de l’autre auprès de qui elle est définitivement désacralisée.
Cependant, le rejet de soi dépasse rarement la femme violée pour se porter sur son groupe. En effet, ce dernier choisit la facilité : le rejet de la victime. Abandonnées par leurs proches, les femmes violées se réfugient dans des hôpitaux ou des foyers pour se reconstruire tant que cela se peut puisque les séquelles physiques, suite aux mutilations sexuelles subies, sont souvent irréversibles et le traumatisme psychologique est pérenne. Pour cause, le viol en temps de guerre s’exerce aussi avec des armes tels que des tessons de bouteilles (guerre d’Algérie), des manches en bois (Rwanda et Congo), etc. La victime est parfois laissée « vivante » pour être la trace de la mort donnée à l’ennemi.
Violée parce que Tutsi
La violence sexuelle en temps de guerre choisit la femme comme passerelle entre deux morts. Le violeur reconnaît, par l’exercice de sa barbarie, sa mort comme être humain. Il n’est plus qu’un monstre, dans la marge du monde. Il compte se rehausser en exerçant un pouvoir infini sur l’autre qu’il compte condamner à mort par contamination – en tuant symboliquement la femme, il tue son groupe. La femme victime des violences sexuelles en temps de guerre ou de conflit est saisie comme agent de contagion. C’est ce qui ressort d’un rapport de la Fédération Internationales des Droits de l’Homme (FIDH) sur le génocide rwandais. On y voit comme les femmes sont violées parce qu’elles appartiennent aux Tutsi.
A partir de ce rapport, on peut retracer le cheminement du ou des violeurs dans ce conflit. Cela commence par un sentiment d’infériorité attisé par la propagande de l’Etat : « Les femmes tutsi étaient considérées comme les plus jolies, ce qui leur attirait de la haine. Le terme Kinyarwanda utilisé pour les désigner était ibizungerezi (ce qui signifie jolie et sexuellement attirante). Cela attisa la jalousie, une haine qu’il n’est plus besoin d’écrire… », déclare un membre de l’Association des femmes chefs de famille. En fait, les extrémistes hutu au pouvoir ont voulu humilier le Hutu pour l’amener à renverser la donne en humiliant le Tutsi. A l’infériorité s’ajoute la peur de la force de la femme. Elle est considérée d’emblée comme une arme au service de son ethnie. Le journal officiel et haineux, Kangura, établit par la plume d’un de ces auteurs, « Les dix commandements du hutu ». Le premier indique que « Tout Muhutu doit savoir que Umututsikazi ou qu’elle soit, travaille à la solde de son ethnie tutsi. » Et de déclarer traître tout Hutu épousant, employant ou protégeant une femme tutsi. La peur de la contagion par l’autre est ici très sensible. Les voix génocidaires manipulent la figure des femmes tutsi et la diabolisent. Elles sont dites « espionnes séduisantes et calculatrices, occupée à dominer et à détruire les Hutu. »
La machine à destruction est alors lancée. Perpétue, une jeune rescapée du génocide, avait 20 ans quand elle a été violée et mutilée par plusieurs groupes de miliciens qui voulaient ainsi prouver qu’ils sont les égaux des Tutsi. Quand elle a été découverte, un Interahamwe lui confie sa connaissance de « la meilleure méthode pour vérifier que les femmes tutsi étaient comme les femmes hutu. » Après son viol, Perpétue a été surveillée par deux hommes qui « se plaignaient d’être fatigués de tous ces massacres. » Ses deux bourreaux se rendent ainsi compte de leur inhumanité. La reconnaissance de leur mort en tant qu’humains les amène à l’extérioriser en mutilant leur victime : « Un d’entre eux aiguisait l’extrémité d’un manche de houe. Ils m’ont écarté les jambes et m’ont violé avec le bâton. » Libérée, elle finit par être reprise par un autre Interahamwe qui pour la « protéger » la viole à son tour et rouvre ses blessures « parce que les femmes tutsi, lui a-t-il dit, n’ont pas de droits en ce moment. »
Abandonnée par son second bourreau, elle fuit difficilement. A la douleur physique, s’ajoute la honte et l’humiliation qui font d’elle un être complètement exclu du monde : « Quand des gens passaient près de moi, je m’asseyais par terre et cessais de marcher, ainsi ils ne sauraient pas que j’avais été violée parce que j’étais honteuse. » On comprend donc le silence qui entoure ces violences. Il s’agit de sauvegarder les liens sociaux avec son groupe, en d’autres termes, d’assurer son rôle de ciment social. Exclue d’elle même, la femme violée loue avec son silence sa place parmi les siens. Le rapport de la FIDH note que les « femmes qui reconnaissent avoir été violées ont peur d’être marquées comme victimes de viols et courir ainsi le risque d’être rejetées par leurs familles et la communauté. »
L’expression courante « vivre la mort dans l’âme » prend ici tout son sens tragique qu’on retrouve dans, entre autres ouvrages mémoriels sur le génocide rwandais, La Phalène des collines.
« Dieu me viole ! »
L’ouvrage de Koulsy Lamko est l’histoire d’une transfiguration nécessaire pour que la mémoire ne travestisse pas, par hypocrisie, l’histoire du viol. La cruauté du crime, pour la narratrice, impose un langage crû. D’une certaine façon, on peut comprendre qu’on nomme le viol en temps de guerre « arme douce » à travers ce passage : « Ils ont la langue lourde, deviennent amnésiques ou aphasiques et cherchent tous leurs mots, quand il faut parler de cul, de vulve, vagin et consorts. Ils balbutient, bégaient, se creusent de profondes tranchées dans la mémoire. Pudibonderie ; pure hypocrisie de cul bénit ! » (p. 19). Cela pose la question de l’approche de l’acte violent à travers des désignations masquant leur cruauté pour ne pas ébranler nos repères et nos définitions des choses. Par ces épithètes et euphémismes, on continue de chercher l’homme en soi alors que « C’est dans l’animal qu’il faut creuser pour déterrer les limites de l’homme. » (p. 35).
La « reine du milieu des vies », transfigurée en papillon de nuit, suit un groupe, invité à travailler sur la mémoire du génocide, la nièce de la Reine, mannequin et actrice improvisée devenue photographe « pour fixer et dire la nausée, l’absurde, l’ineffable, la violence et cela avec cette authenticité que seule apporte la vérité d’œil double. » (p. 101). Le papillon commente cette quête aussi tragique qu’inutile à ses yeux : « Je n’avais cure, dit-elle, qu’on me confectionnât une légende vibrante, larmoyante et émotionnée. Moi-même je ris de mon destin alors… » (p. 18). Entrant dans un « l’église-musée-cimetière », le groupe fait tomber accidentellement les os de la Reine. C’est l’occasion pour la phalène narratrice de prendre la parole et de raconter son histoire que personne, parmi le groupe, n’entendra.
La Reine a été violée par un pasteur qui après avoir joui du corps de sa victime de soixante ans, poursuit son acte avec un crucifix. Lui qui exorcise et « commande aux démons d’évacuer la sainte salle » devient un démon qui s’invite dans le corps d’autrui. Celui qui promet la Vie éternelle détruit la promesse de la vie sur terre : « Le morceau de bois que vous voyez là et qui se plante dans le commencement des frémissements, la caverne du mythe, l’entrée de l’antre où l’obscurité façonne l’homme, l’origine de la vie, la matrice, la source… ce morceau de bois est un pieu… » (p. 21).
Les violences en temps de guerre sont présentées comme le niveau suprême de la consommation de l’Autre. Il s’agit de le voler à lui-même et de l’assimiler définitivement à soi : « Le repas est prêt ! Bon appétit !/ Mangez donc les tartines beurrées de nos cervelles./ Je vous vois saliver un flot dans la bouche ! » (p. 58). C’est l’origine de la violence qui est ainsi supprimée : « Bien sûr que l’autre qui ne vous ressemble pas, “l’insecte” comme on le dit de tout étranger, est une somme de claudications ! La différence reste le seul secret de tous. » (p. 74). L’effacement des différences par les violences sexuelles aboutit à une forme de rejet du corps-prison par l’âme de la victime. C’est ce qui ressort de ce passage de L’Ombre d’Imana de Véronique Tadjo :
Anastasie se réveillait brusquement à l’heure où l’aube pointait et se sentait envahie par la mémoire de son viol. Le soleil avait beau montrer son visage rieur, elle ne le voyait pas. Elle restait emmurée dans la prison de sa chair. (…) Elle ne reconnaissait plus l’intérieur de son corps, se sentait étrangère à cette masse lourde qui écrasait son esprit. (p. 73)
Volée à elle-même, on n’est guère étonné d’entendre la Reine prier Dieu d’ordonner au pasteur de la tuer complètement.
L’une des questions que pose La Phalène des collines porte sur notre manière de lire les différents types de violence en temps de guerre ou de conflit. D’après la narratrice, faire étalage de son émotion est une répétition du crime : « Il ignorait qu’ânonnant mon histoire avec ce fausset ému dans la voix, il chapardait ma douleur, me lacérait davantage, me mutilait, me déchiquetait ! » (p. 18). Néanmoins, on peut se poser la question jusqu’à quel point une lecture et une analyse froides peuvent être efficaces et utiles. Koulsy Lamko propose une posture de lecture de la violence humaine fondée sur la liberté et la volonté de l’individu à désensevelir et à transmettre la mémoire des victimes de l’Histoire : « Tu es en toi, dans ton intérieur, en face de ton intérieur. Cependant il faut et tu dois sont plutôt négation de toi que confection de toi. Par contre – et c’est là que se plante “la philopoésie de la regardance” – tu peux est enfoui dans l’illimité, t’invite au miracle. » (p. 65). Mais cette posture impose le courage de se regarder comme bourreau potentiel, voire comme bourreau symbolique au quotidien. L’absence de ce courage, dont la sincérité est fondatrice, a pour conséquence une dénomination fausse et hypocrite de nos comportements. C’est cette fausse dénomination qui leur permet de se poursuivre.
Koulsy Lamko, La Phalène des collines, Butare (Rwanda), éd. Kuljaama, 2000.



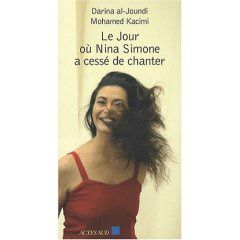 La vision que nous possédons de la guerre est portée par un déferlement télévisuel. Les images rapportées sont souvent celles de bombes, d’immeubles éventrés, de femmes en pleurs, de corps démembrés. Si la parole est donnée aux témoins, le récit sera celui de la fuite, du bruit des avions dans le ciel, de la douleur face à la perte.
La vision que nous possédons de la guerre est portée par un déferlement télévisuel. Les images rapportées sont souvent celles de bombes, d’immeubles éventrés, de femmes en pleurs, de corps démembrés. Si la parole est donnée aux témoins, le récit sera celui de la fuite, du bruit des avions dans le ciel, de la douleur face à la perte. 