Analyse
Des valises sans poignées [1]?
Pour une lecture comparée de Gare du Nord d’Abdelkader Djemaï
et Epitaphe d’Antoine Matha
Par Virginie Brinker
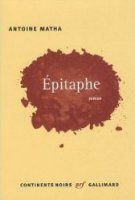
Epitaphe, le premier roman d’Antoine Matha, écrivain originaire du Congo-Brazzaville, publié en 2009[2], entre me semble-t-il en résonance avec l’œuvre de l’écrivain d’origine algérienne Abdelkader Djemaï, Gare du Nord, publiée quant à elle en 2003[3].
En effet, ce sont deux textes qui évoquent des trajectoires parallèles de migrants, mais aussi de formidables histoires d’hommes et d’amitié. 
Bonbon, Bartolo et Zalamite vivent au « Foyer de l’Espérance », tout près de la gare du Nord. Ce sont trois amis d’un certain âge, trois vieux immigrés qui ont connu l’époque où les cartes d’identité mentionnaient encore « Français musulmans d’Algérie ». Raymond et Fargas[4], quant à eux, sont deux jeunes hommes africains qui se rencontrent sur les bancs de l’école (ou plus exactement en se tapant dessus à la récré) et rêvent de partir pour « le pays de Paris[5] », pour fuir la « kleptocratie locale[6] », le premier nourrissant un espoir de jouisseur, et le second des rêves de diplômes plein les yeux, en dépit des avertissements de M. Roussel, leur professeur : « Aujourd’hui comme jadis, c’est la même verroterie qui vous fascine… [7]».
Entre tendresse et dérision
La vie des trois compères de Gare du Nord n’est pas bien gaie, mais jamais le texte ne sombre dans le pathos. Pour rendre compte de la misère des trois hommes, le narrateur opte la plupart du temps pour une écriture plate, blanche, dépourvue d’émotion particulière :
Frileux depuis son enfance, Bonbon était manœuvre dans des chantiers exposés aux duretés du climat et situés le plus souvent loin de son domicile. Le contrat fini, il lui fallait vite chercher un autre emploi. Il aurait aimé être embauché dans une usine, même comme balayeur ou homme à tout faire, pourvu qu’il ait une place stable et un salaire régulier. A l’abri du froid, il aurait alors été moins souvent malade et le mandat qu’il expédiait à sa famille aurait été plus conséquent[8].
Mais le narrateur choisit aussi un ton léger, humoristique, qui met à distance la misère, la vieillesse et la maladie, et fait que le lecteur n’éprouve pas une suffisante compassion pour les personnages, mais au contraire un profond attachement :
Zalamite avait divorcé trois fois et n’avait pas d’enfants. S’il voulait se remarier, comme l’avait prédit Hadj Fofana Bakary, il avait intérêt à bien préserver son petit oiseau, même s’il n’avait plus grand-chose à picorer avec ses trois ou quatre dents qui ne tarderaient pas elles aussi à s’envoler.
En fait, à la lecture, ce qui l’emporte c’est l’indulgente et respectueuse tendresse du regard porté sur « les trois chibanis[9] », trois hommes qui se contentent de peu et partagent ensemble les petits bonheurs du quotidien, trois anonymes d’une humanité toute moyenne et pourtant si universelle :
Les trois vieux ne fumaient ni ne chiquaient. Mais ils avaient toujours soif, à n’importe quelle saison. Ils croyaient au Très-Haut, mais buvaient leur bière sans grand remords et même avec plaisir. Ils espéraient qu’un petit pèlerinage à la Mecque effacerait toutes les ardoises. Un lavage-dégraissage de leur pauvre carcasse, avant d’atteindre la destination suprême où il n’y a, au rayon boissons, que du miel et du lait[10].
Réseaux lexicaux des traditions religieuses et de la modernité du pays de l’exil (marquée tout de même par la réification et la consommation - « lavage-dégraissage », « rayon » -) se mêlent ici avec légèreté, comme si les trois hommes étaient finalement parvenus à un compromis apaisant.
Dans Epitaphe, au contraire, l’opposition des deux cultures correspond à un affrontement radical entre deux systèmes de valeurs[11] et les jeunes hommes en font la découverte frontale, même s’ils n’ont pas la même façon de l’appréhender. En effet, Raymond et Fargas sont comme frères (« un même rythme nous faisait marcher du même pas, à la même cadence[12] »), mais ils sont radicalement différents. Raymond accepte volontiers de jouer les petites crapules pour « sorti[r] de la vie de basse-fosse où [il] croupi[t] [13]», tandis que Fargas intègre l’université. Du point de vue de leur « éducation sentimentale », là aussi les chemins diffèrent. Fargas vit une relation sentimentale d’exception avec Françoise, une jeune métisse, tandis que Raymond accepte pleinement que « dans le pays où il était débarqué, le sexe [soit] une industrie comme une autre[14]. », passant ses soirées à La Palmeraie « la célèbre discothèque où les négroparisiens faisaient la fête[15] ». Raymond devient en effet peu à peu cynique et apprend à profiter des perversions du système : « Il avait également compris le devenir maffieux de la société dite libérale : je deale, tu trafiques, il combine, nous magouillons[16] ».
C’est que la condition de l’immigré se révèle souvent dans le conflit avec d’autres, et ce dans les deux œuvres, que ces « autres » soit Marcel Martinez - le gérant de la brasserie où se retrouvent les trois amis dans Gare du Nord, « un misérable crocodile qui préférait le Pastis aux étrangers » et qui avait oublié « que son propre père, le respectable Enrique Martinez, était venu d’Andalousie, une terre fleurie durant sept siècles par les ancêtres de Zalamite » - ou encore Mme Fernandez (encore un nom hispanique, comme pour dénoncer l’acculturation oublieuse de cette première génération d’immigrés), la coriace employée de la préfecture à laquelle se heurte Fargas par deux fois[17] dans Epitaphe.
Toutefois, le projet esthétique des deux œuvres diffère sensiblement.
Epitaphe évoque en creux Les lettres persanes de Montesquieu, tant par la thématisation de l’étonnement des deux jeunes hommes que par l’écriture. En effet, le champ lexical et les dérivés du terme « étonnement » se déploient à de nombreuses reprises dans le texte, et les deux jeunes hommes ont parfois des airs de Persans débarqués. Citons à titre d’exemple ce passage où Raymond est décontenancé par ses découvertes, alors que c’est habituellement le lot de Fargas dans le roman :
Un corbillard qui nous fait nous arrêter, nous signer et nous recueillir ne suscite que de l’indifférence ! La mort est une affaire courante que l’on bâcle à la va-vite ! Les clochards lui furent aussi matière à réflexion. La solidarité familiale, qui pour lui était un postulat, lui rendait incompréhensible le spectacle de ces gens miséreux et abandonnés : N’ont-ils pas de famille, de frères et de sœurs, Fargas ? Mon ami découvrait une grande ville vraiment moderne et la confrontation lui donnait le vertige[18].
Comme dans le roman épistolaire de Montesquieu, le décalage des personnages, parfois risible, est en fait une arme redoutable pour critiquer les affres de la société de consommation, les valeurs perdues[19], le sexe-roi[20]…
Par ailleurs, il est question, dans les deux œuvres de poétique, via les tentatives scripturales de Fargas dans Epitaphe[21] ou encore le personnage de Med, véritable figure de métatextuelle de l’auteur, dans Gare du Nord. Mais là où les textes de Fargas (cités en italiques à la fin du roman) se centrent sur une écriture de la migrance polémique et satirique, le projet poétique de Gare du Nord (développé à travers les aspirations artistiques de Med au chapitre 9) paraît plus large et plus universel :
Med ne se moquerait pas d’eux comme le faisait Marcel le Jockey ou n’importe qui d’autre. Il était leur interprète, leur intermédiaire, le fils qu’ils auraient peut-être aimé avoir. (…)
Depuis longtemps, il avait le projet d’écrire un livre sur tous les chibanis de Barbès. La Goutte d’Or. Un livre simple et limpide, où ils seraient comme chez eux. Un roman sans graisse et sans prétention qui les accueillerait avec leurs forces, leurs fragilités, leurs tatouages, leurs rides et leurs rêves. (…)
Mais il lui faudrait apprendre à mieux entrer dans le temps des chibanis, dans leurs habitudes, à se glisser dans leurs silences, à lire sur leurs lèvres comme s’ils étaient muets (…) Il lui faudrait aussi trouver le meilleur moyen d’approcher, de cerner, d’évoquer leurs vies qui ressemblaient à une valise sans poignée[22].
La dernière métaphore est magnifique et aurait pu constituer le titre de l’œuvre qu’il nous est donné de lire, car le projet est en définitive profondément humaniste. Il s’agit de « parler de ceux venus d’ailleurs » (p. 70), d’opérer « un voyage vers les autres et vers tous les chibanis » qui « valait la peine d’être accompli » car « ils étaient les derniers d’une histoire courte mais intense[23] ». Le projet esthétique se veut donc traversée de la mémoire et construction de celle-ci, sans doute dans l’espoir de bâtir un présent plus humain.
Le Retour au pays natal comme consécration de l’amitié
Dans Gare du Nord, le « rêve étrange » de Zalamite (raconté dès le chapitre 2), celui de rentrer au pays, est un moteur narratif qui fait imperceptiblement avancer une action par ailleurs toute circulaire, tant elle se fonde sur la routine et la tranquillité de la vie quotidienne des trois chibanis
Ils naviguaient dans les rues comme s’ils étaient condamnés à refaire le même itinéraire, les mêmes haltes, à revoir les mêmes arbres du square, à repasser devant les façades qu’ils longeaient depuis des années[24].
En effet, l’étrangeté du rêve permet d’abord la rencontre du lecteur avec la figure singulière et haute en couleurs de Hadj Fofana Bakary, ce « mage sénégalais[25] », ce « marabout généraliste » que l’on traite « gentiment de charlatan », ami des trois hommes qui partage leur sentiment d’exil. Mais la véritable explication du rêve est peut-être révélée au détour d’une page, en toute discrétion, tant le texte s’attache à maintenir une sorte de distance pudique entre lecteur et personnages, à travers la mention suivante : « Ils redoutaient aussi de mourir loin de leurs proches[26] ».
C’est que la gare, dans le roman d’Abdelkader Djemaï, a tout d’une figure maternelle accueillant en son sein les trois marcheurs invétérés, véritable allégorie de la migrance infinie et éternelle des personnages :
Dès qu’ils approchaient de la gare du Nord, ils se sentaient attirés par une atmosphère chaleureuse, ses formes féminines et par sa lumière douce qui avait la couleur d’une bonne bière. C’était un peu leur port où ils débarquaient au gré de leur humeur, de leur fantaisie. (…)
N’ayant jamais eu de vraies maisons à eux, ils demeuraient là, au milieu des mouvements de la foule, du ballet incessant des bagages, de l’alignement des panneaux publicitaires qui changeaient régulièrement de visage[27].
C’est donc sans doute l’espoir secret de ne pas mourir loin de ses proches qui pousse Bonbon, à la fin de l’ouvrage, à aller passer le Ramadan chez sa fille Badra, même s’il ne connaît personne dans la ville qu’elle habite désormais. Et c’est plein d’espoir qu’il s’envole vers la terre de ses origines, et plein de générosité également, persuadé qu’il va pouvoir, comme le lui a demandé son ami, trouver une femme à Zalamite :
Là-haut, dans l’avion, les bras sur l’accoudoir et la ceinture bien attachée, Bonbon se disait, au milieu des nuages, que Zalamite n’était pas près de perdre les trois ou quatre dents qui lui restaient. Elles lui serviraient peut-être pour la dernière fois à mordre tendrement dans la pomme de l’amour, dans la chair de la vie[28].
… Et c’est finalement sur sa terre que Bonbon quitte celle des hommes, terrassé par une crise cardiaque, condamnant les derniers jours de ses deux amis. De la même façon, l’œuvre d’Antoine Matha se clôt sur un deuil infini, l’épitaphe initiée au début du livre étant reprise à la dernière page, au moment où Fargas rapatrie dans leur pays d’origine, la dépouille de son ami Raymond.
[1] Voir note de bas de page n°21.
[2] Antoine Matha, Epitaphe, Gallimard, « Continents noirs », 2009.
[3] Abdelkader Djemaï, Gare du Nord, Seuil, « Points », 2006 [2003].
[4] Surnom donné au narrateur par son ami Raymond, en hommage au nom de l’acteur qui jouait l’indic dans la série Starsky et Hutch et qui montre combien Raymond est envoûté par la civilisation occidentale, Epitaphe, ibid., p. 23.
[5] Epitaphe, ibid., p. 92.
[6] Epitaphe, ibid., p. 20.
[7] Epitaphe, ibid., p. 34.
[8]Gare du Nord, ibid., p. 52.
[9] Gare du Nord, ibid., p. 16.
[10] Gare du Nord, ibid., p. 16.
[11] Comme l’indique par exemple le passage racontant l’idylle avortée d’Idriss et Mathilde, les parents de Françoise, l’un Malien, l’autre française, et que l’on peut lire comme un apologue au sein du roman, Epitaphe, ibid., p. 65-79.
[12] Epitaphe, ibid., p. 9.
[13] Epitaphe, ibid., p. 40.
[14] Epitaphe, ibid., p. 44.
[15] Epitaphe, ibid., p. 44.
[16]Epitaphe, ibid., p. 94.
[17] Epitaphe, ibid., p.57 et suivantes, puis p. 153 et suivantes.
[18] Epitaphe, ibid., p. 44.
[19] Comme dans le long passage narrant la rencontre de Vincent, le frère de Françoise, avec les musiciens de reggae, pages 98-107. Notons que la musique occupe à partir de ce moment-là une place importante dans l’œuvre, que ce soit le reggae, le tambour ou la musique classique, elle apparaît comme une réponse substantielle face à l’inanité de la société contemporaine. Ce point ne peut être abordé dans le cadre de cet article, mais une réflexion plus élaborée sur le sujet pourrait venir compléter notre dossier n°16 « Littérature et musique » :
http://la-plume-francophone.over-blog.com/categorie-10159235.html
[20] Comme dans le passage très cru de la p. 93.
[21] On peut en lire un florilège, en italiques aux pages 141-150 parmi lesquels « Heurs et malheurs de la télé », « Le bébé et la carte de séjour », « Les joies du supermarché »…
[22] Gare du Nord, ibid., p. 68 puis 70. Nous soulignons l’expression par l’usage d’italiques.
[23] Gare du Nord, ibid., p. 72-73.
[24] Gare du Nord, ibid., p. 34.
[25] Gare du Nord, ibid., citations que l’on retrouvera respectivement aux pages 21, 22 et 23.
[26] Gare du Nord, ibid., p. 29.
[27] Gare du Nord, ibid., p. 39 puis 40.
[28] Gare du Nord, ibid., p. 79.



